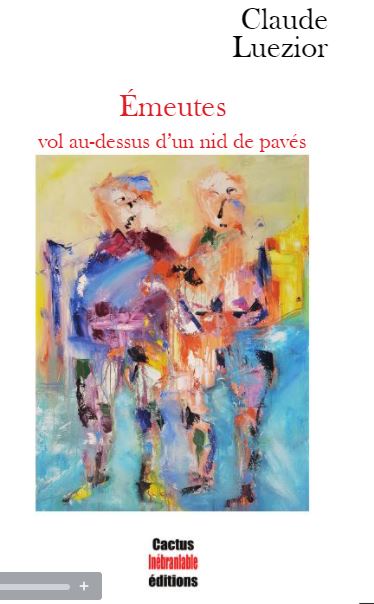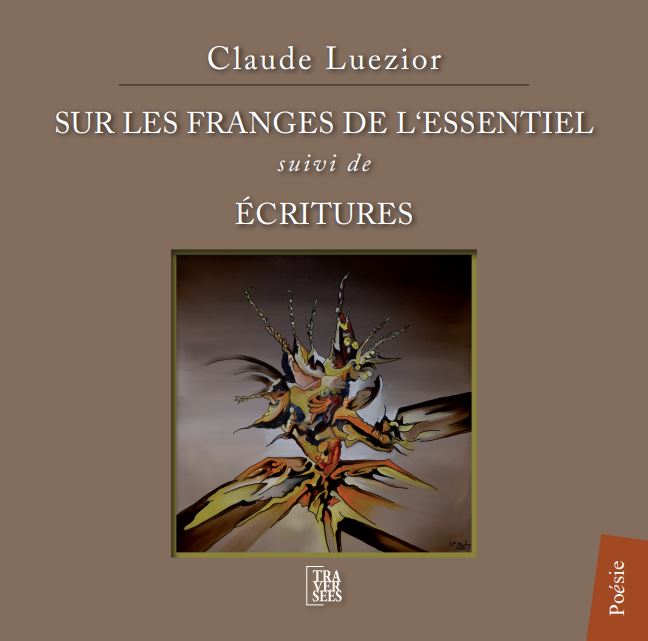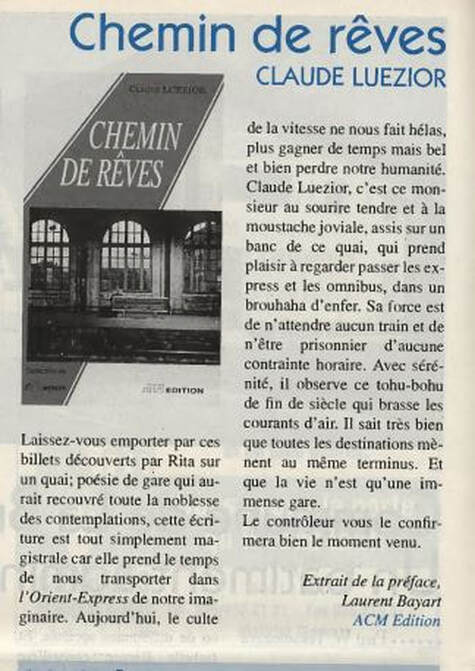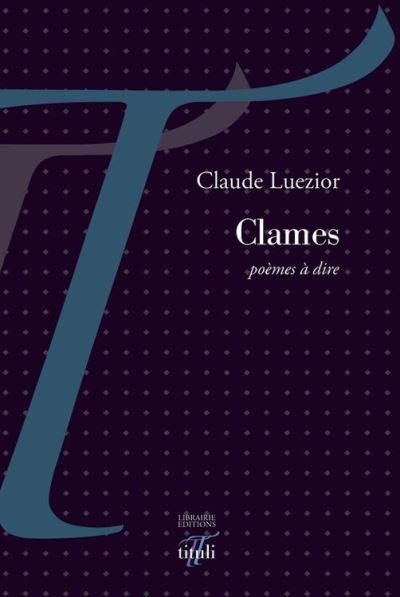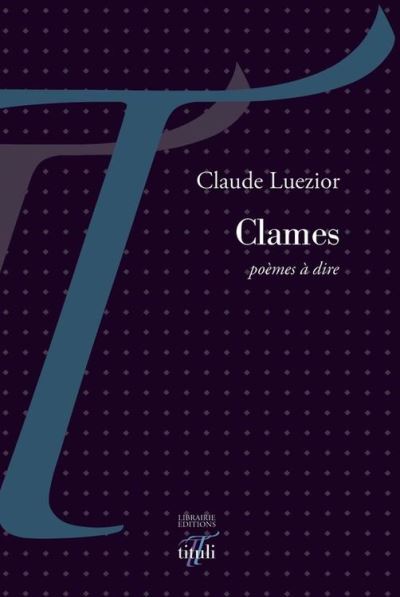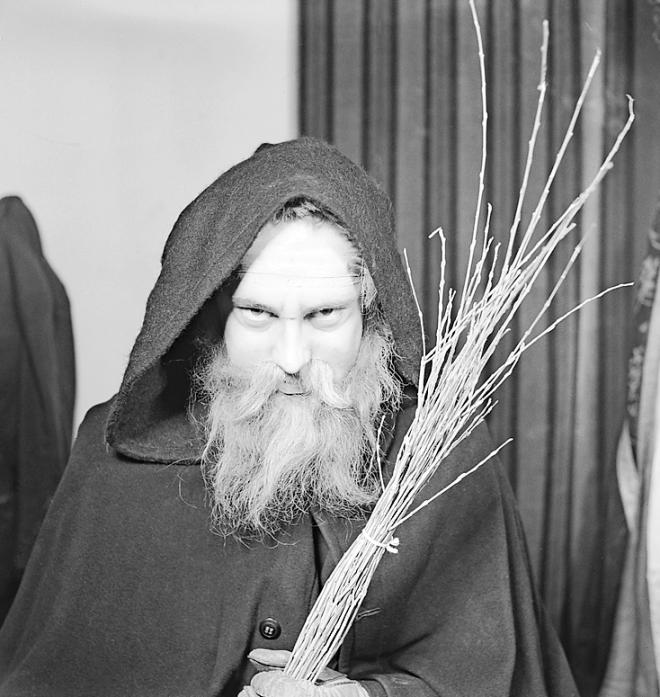Articles et critiques littéraires
Claude Luezior, EMEUTES, VOL AU-DESSUS D’UN NID DE PAVES, Cactus Inébranlable éditions.
Claude Luezior nous propose, avec son nouvel opus littéraire, une joyeuseté en mode sédition et autre révolution, battant le pavé où se trouve la plage ! Il livre ainsi le lecteur à la meute ou plutôt à l’émeute, faisant danser Gavroche et Marianne au son de la Carmagnole, à moins que cela ne soit qu’une bossa-nova endiablée des gilets jaunes ou des drapeaux rouges ? L’auteur serait-il pavé de bonnes intentions ? Pas si sûr…cet hyperactif, et parfois déjanté, est à la fois homme de plume, neurologue, professeur de médecine à l’université et père de quatre fils…Nous voilà prévenus ! Avec un humour décapant (à faire glousser les barricades !), il nous dresse –judicieusement – l’inventaire du parfait émeutier : trois douzaines de mégaphones (avec des piles neuves achetées sur la caissette du patron) en rajoutant (espiègle et casse-tête) une guillotine en carton-pâte, juste pour rappeler au Roi qu’on a de la mémoire…
L’écrivain fribourgeois nous offre une savoureuse variation, un concerto de rébellion sur macadam, se métamorphosant en Poulbot des mots en floraison printanière : Plus que jamais, le métro-boulot-dodo du cher Pierre Béarn, ses échevelés de mai 68 et leurs flamboyantes barricades ne semblent plus que rêves pour apprentis pyromanes. Des gardes mobiles sont alignés prêts à en découdre avec les agitateurs de macadam, tandis que se diluent aquarelles et lavis : désormais s’escriment les couteaux. Les ambulances pimponnent, emmenant avec eux les borgnes et autres « gueules cassées ».
Cela castagne sous l’air des lampions ! Serait-ce le Grand Soir annoncé ? Les voitures sur les toits, tels des insectes renversés, ont la tête de guingois, les black block complotant contre les Lumières, tous feux éteints, l’obscurantisme s’affiche sur un drapeau à tête de mort. Les pirates ont déserté leurs rafiots. Plus loin, quelques boutiquiers et commerçants reconstituent le puzzle de leurs vitrines éclatées. Congestionné, le périphérique est un boa qui ne parvient pas à digérer sa proie. Combien sont-ils ? Un certain nombre selon la police, un nombre certain, selon les syndicats…
Dans cet embrouillamini de slogans et de tintamarre, Claude Luezior, en garde suisse, le stylo dressé comme une javeline, observe ces défilés carnavalesques. La révolte a encore de beaux jours devant elle, mais à l’instar d’un Paris-Roubaix, encore faut-il que les cantonniers laissent les pavés sur la chaussée, tel un trésor de musée sur la cheminée d’un ancien détrousseur de bourgeois : Les tignasses ont blanchi mais un serment fraternel couve encore dans leur gosier.
Tandis que notre ami écrivain rajoute, la moustache taquine, son antienne de révolté du verbe et de l’écriture : « Sous les pavés, la… page ! »
Laurent BAYART
in : Revus alsacienne de littérature (RAL) 2022
Claude LUEZIOR, Sur les franges de l’essentiel suivi de Ecritures, Éditions revue Traversées, 2021.
Prévu en 2021 et consigné en tant que tel, l’ouvrage de Claude Luezior a finalement paru mi-2022 chez les Editions de la revue belge Traversées. Ce nouvel opus de l’écrivain fribourgeois constitue – comme d’habitude – un enchantement poétique et une gourmandise de mots. En épicurien du vocabulaire, il défend toujours avec verve la belle écriture et fustige l’art inclusif et l’idiome des sms, cet art du raccourci qui fait de la syntaxe une ombre boiteuse et sans charme : Courriels, twitter, fake news prolifèrent tels des criquets.
Et de rajouter, sarcastique et lucide : Depuis belle lurette, se sont éteintes les Lumières. Adepte de l’écriture à l’ancienne, il chante les vertus de la bonne vieille plume, voire du stylo très habile : Lentement, entre mes phalanges, se calcine ma plume. Pourra-t-on en dire autant d’un clavier ? Claude Luezior ne nous confie-t-il pas que les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d’amour. Orfèvre et orpailleur, il nous entraine dans cette calligraphie, temps où l’être humain n’était pas si (op)pressé, pour le velouté des mots/ et les ferments/ à nos points d’orgue/ subtilement partagés. Lire Luezior, c’est comme se régaler d’un menu gastronomique dans un grand restaurant, celui de l’écriture, tandis que ce matin, le bestiaire des mots semble se taire. Ondule encore faiblement la luciole d’un adjectif.
Autrement dit, le verbe se fait lumière pour nous entraîner dans le grand commencement du monde et de l’histoire humaine. Limier et garde champêtre de la précision et autre horlogerie littéraire, je me mets à la chasse des fautes d’orthographe, comme d’autres jouent aux chasseurs de papillons. Et dans son filet vagabond, il récolte une multitude d’ailes multicolores à faire jubiler un Petit Robert en goguette. Inlassable distillateur d’humour, Luezior lance – espiègle - : Les polices de caractère (Dieu sait si mon caractère rebelle rechigne devant ladite maréchaussée !) sont certes innombrables mais aucune ne correspond vraiment à la fibre de mes doigts.
Et puis, au détour d’une page, il lâche comme on éparpille, à la discrétion du vent, les confettis d’un testament : J’aimerais tellement qu’un jour, des amoureux esquissent une ou deux de mes lignes sur la tombe qui sera mienne !
Gageons que même sa pierre tombale sera une friandise de mots, les cimetières n’étant finalement que des dictionnaires où les lettres se couchent avant qu’un démiurge alphabétique ne les réveille à jamais…Dieu ayant des taches d’encre sur ses doigts. L’éternité ne possède pas de point final dans sa besace !
Laurent BAYART
in Revue alsacienne de littérature (RAL), 2022
Claude Luezior nous propose, avec son nouvel opus littéraire, une joyeuseté en mode sédition et autre révolution, battant le pavé où se trouve la plage ! Il livre ainsi le lecteur à la meute ou plutôt à l’émeute, faisant danser Gavroche et Marianne au son de la Carmagnole, à moins que cela ne soit qu’une bossa-nova endiablée des gilets jaunes ou des drapeaux rouges ? L’auteur serait-il pavé de bonnes intentions ? Pas si sûr…cet hyperactif, et parfois déjanté, est à la fois homme de plume, neurologue, professeur de médecine à l’université et père de quatre fils…Nous voilà prévenus ! Avec un humour décapant (à faire glousser les barricades !), il nous dresse –judicieusement – l’inventaire du parfait émeutier : trois douzaines de mégaphones (avec des piles neuves achetées sur la caissette du patron) en rajoutant (espiègle et casse-tête) une guillotine en carton-pâte, juste pour rappeler au Roi qu’on a de la mémoire…
L’écrivain fribourgeois nous offre une savoureuse variation, un concerto de rébellion sur macadam, se métamorphosant en Poulbot des mots en floraison printanière : Plus que jamais, le métro-boulot-dodo du cher Pierre Béarn, ses échevelés de mai 68 et leurs flamboyantes barricades ne semblent plus que rêves pour apprentis pyromanes. Des gardes mobiles sont alignés prêts à en découdre avec les agitateurs de macadam, tandis que se diluent aquarelles et lavis : désormais s’escriment les couteaux. Les ambulances pimponnent, emmenant avec eux les borgnes et autres « gueules cassées ».
Cela castagne sous l’air des lampions ! Serait-ce le Grand Soir annoncé ? Les voitures sur les toits, tels des insectes renversés, ont la tête de guingois, les black block complotant contre les Lumières, tous feux éteints, l’obscurantisme s’affiche sur un drapeau à tête de mort. Les pirates ont déserté leurs rafiots. Plus loin, quelques boutiquiers et commerçants reconstituent le puzzle de leurs vitrines éclatées. Congestionné, le périphérique est un boa qui ne parvient pas à digérer sa proie. Combien sont-ils ? Un certain nombre selon la police, un nombre certain, selon les syndicats…
Dans cet embrouillamini de slogans et de tintamarre, Claude Luezior, en garde suisse, le stylo dressé comme une javeline, observe ces défilés carnavalesques. La révolte a encore de beaux jours devant elle, mais à l’instar d’un Paris-Roubaix, encore faut-il que les cantonniers laissent les pavés sur la chaussée, tel un trésor de musée sur la cheminée d’un ancien détrousseur de bourgeois : Les tignasses ont blanchi mais un serment fraternel couve encore dans leur gosier.
Tandis que notre ami écrivain rajoute, la moustache taquine, son antienne de révolté du verbe et de l’écriture : « Sous les pavés, la… page ! »
Laurent BAYART
in : Revus alsacienne de littérature (RAL) 2022
Claude LUEZIOR, Sur les franges de l’essentiel suivi de Ecritures, Éditions revue Traversées, 2021.
Prévu en 2021 et consigné en tant que tel, l’ouvrage de Claude Luezior a finalement paru mi-2022 chez les Editions de la revue belge Traversées. Ce nouvel opus de l’écrivain fribourgeois constitue – comme d’habitude – un enchantement poétique et une gourmandise de mots. En épicurien du vocabulaire, il défend toujours avec verve la belle écriture et fustige l’art inclusif et l’idiome des sms, cet art du raccourci qui fait de la syntaxe une ombre boiteuse et sans charme : Courriels, twitter, fake news prolifèrent tels des criquets.
Et de rajouter, sarcastique et lucide : Depuis belle lurette, se sont éteintes les Lumières. Adepte de l’écriture à l’ancienne, il chante les vertus de la bonne vieille plume, voire du stylo très habile : Lentement, entre mes phalanges, se calcine ma plume. Pourra-t-on en dire autant d’un clavier ? Claude Luezior ne nous confie-t-il pas que les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d’amour. Orfèvre et orpailleur, il nous entraine dans cette calligraphie, temps où l’être humain n’était pas si (op)pressé, pour le velouté des mots/ et les ferments/ à nos points d’orgue/ subtilement partagés. Lire Luezior, c’est comme se régaler d’un menu gastronomique dans un grand restaurant, celui de l’écriture, tandis que ce matin, le bestiaire des mots semble se taire. Ondule encore faiblement la luciole d’un adjectif.
Autrement dit, le verbe se fait lumière pour nous entraîner dans le grand commencement du monde et de l’histoire humaine. Limier et garde champêtre de la précision et autre horlogerie littéraire, je me mets à la chasse des fautes d’orthographe, comme d’autres jouent aux chasseurs de papillons. Et dans son filet vagabond, il récolte une multitude d’ailes multicolores à faire jubiler un Petit Robert en goguette. Inlassable distillateur d’humour, Luezior lance – espiègle - : Les polices de caractère (Dieu sait si mon caractère rebelle rechigne devant ladite maréchaussée !) sont certes innombrables mais aucune ne correspond vraiment à la fibre de mes doigts.
Et puis, au détour d’une page, il lâche comme on éparpille, à la discrétion du vent, les confettis d’un testament : J’aimerais tellement qu’un jour, des amoureux esquissent une ou deux de mes lignes sur la tombe qui sera mienne !
Gageons que même sa pierre tombale sera une friandise de mots, les cimetières n’étant finalement que des dictionnaires où les lettres se couchent avant qu’un démiurge alphabétique ne les réveille à jamais…Dieu ayant des taches d’encre sur ses doigts. L’éternité ne possède pas de point final dans sa besace !
Laurent BAYART
in Revue alsacienne de littérature (RAL), 2022
Claude Luezior, Sur les franges de l'essentiel suivi de Écritures
© 2022 Éditions Traversées, Virton, Belgique
ISBN : 9782931077047, 128 pages
Recension par Gérard le Goff
Selon le dictionnaire, le terme « frange » évoque « la limite imprécise de quelque chose », autant dire une zone indiscernable. le mot peut avoir pour synonyme « marge ». Quant au substantif « essentiel » il désigne tout ce qui paraît indispensable. Concernant le livre de Claude Luezior, ces deux éléments de langage quasi antonymes s'associent pour constituer un titre qui évoque un lieu. Pour autant, il ne s'agit pas ici de cartographier l'indéfini ou le primordial. le lieu évoqué est celui — idéalisé — de la création (artistique, poétique et philosophique). L'acte de création seul permet à l'être humain de se situer dans l'universel et de tenter de lui appartenir. Un acte qui ne peut être rendu possible qu'avec l'apparition de l'écriture.
Dans un remarquable Liminaire, l'auteur esquisse une histoire de l'écriture. Cet acte fondateur de l'humanité se confond à l'origine avec l'art. Georges Bataille dans son Lascaux ou la naissance de l'art considère que les peintures rupestres témoignent du moment (qu'il qualifie de « miracle »), sans aucun antécédent historique (en 1955, date de parution de son livre, le site de Lascaux s'avérait unique en son genre), où l'homme parvient à transcender son animalité. L'art pariétal est aussi écriture. Sans savoir ni pouvoir la nommer, l'homme des cavernes exprime pour la toute première fois sa relation au monde en la peignant. Il laisse aussi une trace lisible que pourront s'approprier ses descendants.
La suite est une évocation vertigineuse de l'évolution de l'écriture. La parole est longtemps gravée dans la pierre, une pierre souvent tombale. En l'absence de tout rite funéraire, nous ne saurions rien des civilisations passées. « Les idéogrammes fixent la voix humaine. Pouvoir compter, figer son urgence sur le sarcophage, pierre qui mange la chair. » Puis succèdent au minéral les supports végétaux et les peaux traitées « devenues imputrescibles », se substituent aux gravelets les stylets, les pinceaux, l'usage de l'encre et des pigments, toutes pratiques qui rattachent encore et toujours l'écriture à l'art.
Tout s'accélère. « Déjà se profilent avec fracas les presses de Gutenberg, la liberté de pensée, Montaigne, Descartes, les Lumières. »
Aujourd'hui, notre société est noyée sous des informations non classées (le futile se situe au même niveau que le grave : le football, la guerre), voire même fausses ou invérifiables, toujours éphémères. Comme le notait René Char : « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Des machines à l'obsolescence programmée déversent de soi-disant nouvelles dans nos cerveaux saturés quand « les dessins des cavernes ou ceux des pyramides ont survécu durant des millénaires […] ».
Tout au long de cet ouvrage, des poèmes au lyrisme contenu — mais non point contraint — alternent, selon un rythme assez régulier, avec des incises en prose, typographiées en italique, qui souvent — tant par leur brièveté que par leur portée — ont valeur d'aphorismes. Une présentation qui fait songer aux répons. le poète est sensible à un certain cérémonial.
A la lecture de cette suite, on est tenté d'inventorier diverses thématiques. Mais elles s'enchevêtrent de si subtile manière que l'entreprise s'avère vaine et ne peut épuiser la richesse d'un tel livre.
Le poète se souvient qu'on lui a enseigné Dieu concevoir l'univers en donnant un nom à chacun de ses éléments constitutifs. La langue a le pouvoir de créer. C'est le pouvoir du « verbatim » : ce qui est écrit doit exister. Aux yeux de l'auteur, cette parole divine s'est par la suite incarnée dans la poésie. C'est la parole première. Celle du démiurge. En découvrir une trace c'est s'approprier « […] un coquillage sacré / où luit la nacre / de tous les désirs ». La poésie est l'expression privilégiée des civilisations antiques. Elle se perpétue dans le roman des oeuvres médiévales et persiste dans l'alexandrin des chefs d'oeuvre classiques. Elle ne constitue pas pour autant une liturgie figée, ne relève pas du dogme, mais vaut « cent mille médecines / pour espérants d'une foi / sans Tables de la loi / juste l'appel d'un bonheur / d'un bonheur souche / pour extases embryonnaires ».
La poésie est une parole exigeante et lucide. Elle s'oppose au verbiage des puissants, à cette prose devenue une « novlangue » gangrenée par un anglais dévoyé (véritable jargon des affaires). le poète a pris conscience de la délitescence de nos sociétés postmodernes : « Des ingénieurs frénétiques mettent leur génie à programmer dès son enfance la fin, si possible toute proche, de leur système.
Comme si une mère s'ingéniait à cultiver les gènes de la mort dans ses propres ovules. » le poète, lui, nomme l'essentiel pour qu'il puisse demeurer et dénonce la déshumanisation « pour rassurer / panser, sauver / aimer / sachant que la partie / sera un jour perdue ». Semblent lui donner raison ces démocraties qui chancellent, où l'on voit des citoyens lobotomisés en arriver à élire à la présidence de leur pays le cireur de chaussures d'un banquier.
Il convient de faire oeuvre de résistance en témoignant pour les générations à venir « pour que survive / une manière d'essentiel / nous avons calligraphié / sur l'épiderme de nos chairs / écrouelles, cicatrices / et spasmes insensés / que l'on appelle poésie ». Mais si la poésie veut « traduire comme un combat / aux heures carnassières / pour une conscience / au-delà de l'artificiel », elle se refuse au militantisme car elle est « non pas figuration / d'une croyance / mais principe vital ».
Un leitmotiv traverse l'oeuvre de Claude Luezior tel un motif musical : l'affirmation d'une joie de vivre et son corollaire l'espérance. Car l'écriture est aussi un acte de foi. Il faut compter sur un renouveau possible. « [J]e ne cesse de penser / à ces vies souterraines / qui se font sève ou ferment / et nourrissent les racines / d'anonymes herbages / ou de jonquilles éperdues ». Il faut retrouver la hardiesse du démiurge et présumer que l'amour de son prochain comme celui de la nature sont les garants d'une évolution positive. Même si la menace est là, grandissante, même si le poète sait que « [n]oire ou bubonique la peste s'est donnée du mal pour mieux faire. » Et puis, l'amour toujours, l'amour tout court. Comme lorsqu'il est invoqué avec grâce dans le texte C'est un petit moine : « car les instants d'amour / d'amour fugace et pur / il les a inventés / avant le crucifix / quand ses bras traduisaient / les gestes de la tendresse ».
Le livre s'achève avec le poème Chromatique qui fait écho au texte d'introduction Liminaire. On parle à nouveau de peinture. Dans le monde actuel. Fracassé. L'acte de peindre décrit comme un dernier sursaut de révolte. A l'instar du poète (« voici mon refus d'être ce que vous attendiez de moi »), l'artiste adresse aux dirigeants de ce monde malade une fin de non recevoir et poursuit son « combat de l'extrême / comme si le carmin / était sa dernière chance / et l'ocre / son ultime bol / de lumière / délire / d'une survie / incertaine ».
Le deuxième recueil composant le volume se présente comme un ensemble de textes courts, rédigés en prose et tous intitulés. le titre de l'ouvrage l'indique sans ambages, Claude Luezior traite ici de l'acte d'écrire. le ton est moins lyrique — quoique ! —, plus ironique, sarcastique même… D'emblée, l'auteur nous gratifie d'une étrange recommandation : « Ô lecteur, surtout n'écris jamais. N'avoue jamais ! Car tes mots resteront à charge. » Pour aussitôt après nous conseiller de « buriner » notre page. Faudrait savoir ! On comprend entre les lignes — évidemment ! — qu'on ne peut se passer de l'écriture. « Les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d'amour. » le phénomène est contagieux. Quelqu'un avança un jour le postulat qu'il existait en France plus de poètes que de lecteurs de poésie.
S‘en suivent de savoureuses considérations sur la langue, si maltraitée de nos jours, entre les anglicismes de pacotille, les slogans publicitaires débiles, les délires inclusifs des nouveaux Trissotins et les borborygmes flatulents d'un quarteron de barbaresques abrutis.
Le poète évolue entre amertume et anathème. « Ma plume s'est cassée. Pas sûr qu'un clavier la remplace. » On songe à Philippe Sollers qui débutait chacun de ses séjours à Venise par l'achat d'une bouteille d'encre chez un immuable marchand. Un cérémonial étonnant qui touche au sacré.
Cependant quelques prophètes de malheur « prétendent que le Verbe est mort. » Selon ces corbeaux de mauvais augure, rien de l'ardeur créatrice de l'artiste pariétal ne subsisterait aujourd'hui. Mais Claude Luezior « d'un naturel optimiste » réfute ce lugubre augure et affirme : « [d]ans la complexité d'une fin de nuit, renaît le miracle langagier de l'aube. Et chantent les mots d'une oraison nouvelle. » Quoi ajouter de plus ?
© 2022 Gérard le Goff (in : Babelio, 2022)
Claude Luezior, Sur les franges de l'essentiel suivi de Écritures
© 2022 Éditions Traversées, Virton, Belgique
ISBN : 9782931077047, 128 pages
Recension par Gérard le Goff
Selon le dictionnaire, le terme « frange » évoque « la limite imprécise de quelque chose », autant dire une zone indiscernable. le mot peut avoir pour synonyme « marge ». Quant au substantif « essentiel » il désigne tout ce qui paraît indispensable. Concernant le livre de Claude Luezior, ces deux éléments de langage quasi antonymes s'associent pour constituer un titre qui évoque un lieu. Pour autant, il ne s'agit pas ici de cartographier l'indéfini ou le primordial. le lieu évoqué est celui — idéalisé — de la création (artistique, poétique et philosophique). L'acte de création seul permet à l'être humain de se situer dans l'universel et de tenter de lui appartenir. Un acte qui ne peut être rendu possible qu'avec l'apparition de l'écriture.
Dans un remarquable Liminaire, l'auteur esquisse une histoire de l'écriture. Cet acte fondateur de l'humanité se confond à l'origine avec l'art. Georges Bataille dans son Lascaux ou la naissance de l'art considère que les peintures rupestres témoignent du moment (qu'il qualifie de « miracle »), sans aucun antécédent historique (en 1955, date de parution de son livre, le site de Lascaux s'avérait unique en son genre), où l'homme parvient à transcender son animalité. L'art pariétal est aussi écriture. Sans savoir ni pouvoir la nommer, l'homme des cavernes exprime pour la toute première fois sa relation au monde en la peignant. Il laisse aussi une trace lisible que pourront s'approprier ses descendants.
La suite est une évocation vertigineuse de l'évolution de l'écriture. La parole est longtemps gravée dans la pierre, une pierre souvent tombale. En l'absence de tout rite funéraire, nous ne saurions rien des civilisations passées. « Les idéogrammes fixent la voix humaine. Pouvoir compter, figer son urgence sur le sarcophage, pierre qui mange la chair. » Puis succèdent au minéral les supports végétaux et les peaux traitées « devenues imputrescibles », se substituent aux gravelets les stylets, les pinceaux, l'usage de l'encre et des pigments, toutes pratiques qui rattachent encore et toujours l'écriture à l'art.
Tout s'accélère. « Déjà se profilent avec fracas les presses de Gutenberg, la liberté de pensée, Montaigne, Descartes, les Lumières. »
Aujourd'hui, notre société est noyée sous des informations non classées (le futile se situe au même niveau que le grave : le football, la guerre), voire même fausses ou invérifiables, toujours éphémères. Comme le notait René Char : « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Des machines à l'obsolescence programmée déversent de soi-disant nouvelles dans nos cerveaux saturés quand « les dessins des cavernes ou ceux des pyramides ont survécu durant des millénaires […] ».
Tout au long de cet ouvrage, des poèmes au lyrisme contenu — mais non point contraint — alternent, selon un rythme assez régulier, avec des incises en prose, typographiées en italique, qui souvent — tant par leur brièveté que par leur portée — ont valeur d'aphorismes. Une présentation qui fait songer aux répons. le poète est sensible à un certain cérémonial.
A la lecture de cette suite, on est tenté d'inventorier diverses thématiques. Mais elles s'enchevêtrent de si subtile manière que l'entreprise s'avère vaine et ne peut épuiser la richesse d'un tel livre.
Le poète se souvient qu'on lui a enseigné Dieu concevoir l'univers en donnant un nom à chacun de ses éléments constitutifs. La langue a le pouvoir de créer. C'est le pouvoir du « verbatim » : ce qui est écrit doit exister. Aux yeux de l'auteur, cette parole divine s'est par la suite incarnée dans la poésie. C'est la parole première. Celle du démiurge. En découvrir une trace c'est s'approprier « […] un coquillage sacré / où luit la nacre / de tous les désirs ». La poésie est l'expression privilégiée des civilisations antiques. Elle se perpétue dans le roman des oeuvres médiévales et persiste dans l'alexandrin des chefs d'oeuvre classiques. Elle ne constitue pas pour autant une liturgie figée, ne relève pas du dogme, mais vaut « cent mille médecines / pour espérants d'une foi / sans Tables de la loi / juste l'appel d'un bonheur / d'un bonheur souche / pour extases embryonnaires ».
La poésie est une parole exigeante et lucide. Elle s'oppose au verbiage des puissants, à cette prose devenue une « novlangue » gangrenée par un anglais dévoyé (véritable jargon des affaires). le poète a pris conscience de la délitescence de nos sociétés postmodernes : « Des ingénieurs frénétiques mettent leur génie à programmer dès son enfance la fin, si possible toute proche, de leur système.
Comme si une mère s'ingéniait à cultiver les gènes de la mort dans ses propres ovules. » le poète, lui, nomme l'essentiel pour qu'il puisse demeurer et dénonce la déshumanisation « pour rassurer / panser, sauver / aimer / sachant que la partie / sera un jour perdue ». Semblent lui donner raison ces démocraties qui chancellent, où l'on voit des citoyens lobotomisés en arriver à élire à la présidence de leur pays le cireur de chaussures d'un banquier.
Il convient de faire oeuvre de résistance en témoignant pour les générations à venir « pour que survive / une manière d'essentiel / nous avons calligraphié / sur l'épiderme de nos chairs / écrouelles, cicatrices / et spasmes insensés / que l'on appelle poésie ». Mais si la poésie veut « traduire comme un combat / aux heures carnassières / pour une conscience / au-delà de l'artificiel », elle se refuse au militantisme car elle est « non pas figuration / d'une croyance / mais principe vital ».
Un leitmotiv traverse l'oeuvre de Claude Luezior tel un motif musical : l'affirmation d'une joie de vivre et son corollaire l'espérance. Car l'écriture est aussi un acte de foi. Il faut compter sur un renouveau possible. « [J]e ne cesse de penser / à ces vies souterraines / qui se font sève ou ferment / et nourrissent les racines / d'anonymes herbages / ou de jonquilles éperdues ». Il faut retrouver la hardiesse du démiurge et présumer que l'amour de son prochain comme celui de la nature sont les garants d'une évolution positive. Même si la menace est là, grandissante, même si le poète sait que « [n]oire ou bubonique la peste s'est donnée du mal pour mieux faire. » Et puis, l'amour toujours, l'amour tout court. Comme lorsqu'il est invoqué avec grâce dans le texte C'est un petit moine : « car les instants d'amour / d'amour fugace et pur / il les a inventés / avant le crucifix / quand ses bras traduisaient / les gestes de la tendresse ».
Le livre s'achève avec le poème Chromatique qui fait écho au texte d'introduction Liminaire. On parle à nouveau de peinture. Dans le monde actuel. Fracassé. L'acte de peindre décrit comme un dernier sursaut de révolte. A l'instar du poète (« voici mon refus d'être ce que vous attendiez de moi »), l'artiste adresse aux dirigeants de ce monde malade une fin de non recevoir et poursuit son « combat de l'extrême / comme si le carmin / était sa dernière chance / et l'ocre / son ultime bol / de lumière / délire / d'une survie / incertaine ».
Le deuxième recueil composant le volume se présente comme un ensemble de textes courts, rédigés en prose et tous intitulés. le titre de l'ouvrage l'indique sans ambages, Claude Luezior traite ici de l'acte d'écrire. le ton est moins lyrique — quoique ! —, plus ironique, sarcastique même… D'emblée, l'auteur nous gratifie d'une étrange recommandation : « Ô lecteur, surtout n'écris jamais. N'avoue jamais ! Car tes mots resteront à charge. » Pour aussitôt après nous conseiller de « buriner » notre page. Faudrait savoir ! On comprend entre les lignes — évidemment ! — qu'on ne peut se passer de l'écriture. « Les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d'amour. » le phénomène est contagieux. Quelqu'un avança un jour le postulat qu'il existait en France plus de poètes que de lecteurs de poésie.
S‘en suivent de savoureuses considérations sur la langue, si maltraitée de nos jours, entre les anglicismes de pacotille, les slogans publicitaires débiles, les délires inclusifs des nouveaux Trissotins et les borborygmes flatulents d'un quarteron de barbaresques abrutis.
Le poète évolue entre amertume et anathème. « Ma plume s'est cassée. Pas sûr qu'un clavier la remplace. » On songe à Philippe Sollers qui débutait chacun de ses séjours à Venise par l'achat d'une bouteille d'encre chez un immuable marchand. Un cérémonial étonnant qui touche au sacré.
Cependant quelques prophètes de malheur « prétendent que le Verbe est mort. » Selon ces corbeaux de mauvais augure, rien de l'ardeur créatrice de l'artiste pariétal ne subsisterait aujourd'hui. Mais Claude Luezior « d'un naturel optimiste » réfute ce lugubre augure et affirme : « [d]ans la complexité d'une fin de nuit, renaît le miracle langagier de l'aube. Et chantent les mots d'une oraison nouvelle. » Quoi ajouter de plus ?
© 2022 Gérard le Goff (in : Babelio, 2022)
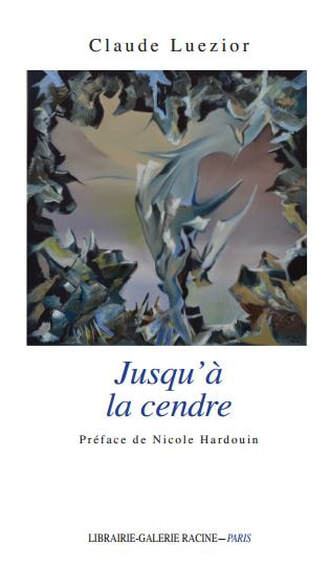
Main dans la glaise du langage, Luezior pourfend les orages de la violence lorsque goutte à goutte / leur sang/ ne cesse / de ruisseler / jusqu'à nous. Il plante ses banderilles dans les convulsions du quotidien : l’enfant sans âge se colle / à un sein lactescent / sur le pavé se confondent / leurs corps de misère.
Penché sur les torsions de la douleur, il palpe les versets de la souffrance, essaie de déjouer les ruses incongrues du mal pour colmater le trop mince filet de sève. Résistance.
Grand veneur, il conduit sa meute de mots jusqu’au seuil de l’hallali. Alors, dans les zébrures du soir, au rythme des heures où gémissent encore les silences, le cortège des ombres lentement s’étire et floconne sa solitude. Combat.
Tissage de rêveries, armoiries de souvenirs encore vivaces, serments devenus chauves-souris, lieu de caresses que les heures ont momifiées. Mais, dans cette âpreté existentielle, parfois, d’une épaule / peuplée de tendresse montent des semailles de lumière. Avant que ne s’ébruitent / les fureurs de la ville, le poète écaille les tessons du rêve. Duel.
Claude Luezior, braconnier d'une ivresse, entre les franges d'une aube en gésine où naissent les énergies de nos lèvres offertes, conserve sur ses rivages des baies écarlates : vers toi j'ouvre mes paupières. Il caresse des braises qui corrodent et s’enfoncent dans le jardin premier / à portée de regard. Promesse.
À la reliure des cicatrices, quand se dévoile l’épure sacrée de tes désirs, les rives du poète chavirent de gourmandise. La lie devient ambroisie pour découdre / lèvres à lèvres / l’impudeur d’un jouir / en ce dédale où jaillissent des geysers interdits.
Dans ce recueil se côtoient la violence, la vie sacrifiée par la vie, la mort qui entrouvre l’ossuaire de ses secrets, le djihad et ses vengeance poisseuses / qui ne sont que reliefs d’une haine. Mais aussi la compassion et l’amour, omniprésents, hiératiques : affamés de tendresse, les mots adoptent la coagulation d'un silence. Le poète insatiable traduit le fracas en musique, le désordre en lettres d’or.
Incessante dualité : au cœur de la trame, veille malgré tout la camarde. Éros et Thanatos sédimentent Jusqu'à la lie. S'écorchent les neurones en dérive / qui vaguent et divaguent, jusqu'à la déstructuration de la page dans le texte Alzheimer au lieu d'aimer. Comme si cette lie de Luezior était l'ultime supplique écrite par la démence elle-même. Bataille acharnée, perdue d'avance, dans la noirceur espérante d'une désespérance.
Nicole Hardouin
Editions Librairie-Galerie Racine, Paris, 2018
CLAUDE LUEZIOR : Une dernière brassée de lettres, Paris, Librairie
Éditions Tituli, 2016, 82 p. ; Fragile. Poèmes, Charlieu, La
Bartavelle éditeur, 1999, 112 p. ; Mendiant d’utopie. Poésie, Paris,
L’Harmattan, 2009, 100 p. ; Vent debout !, Colombes, Encres vives,
2011, « Encres vives ».
Claude Luezior, médecin-neurologue et professeur d’université, est un
écrivain connu et reconnu. Il est l’auteur de romans, nouvelles,
textes courts, poèmes, aphorismes, proses poétiques, ouvrages
scientifiques et textes de livres d’art. Un personnage complet, donc,
dans le monde de la littérature et de l’art.
Dans le premier texte, Une dernière brassée de lettres, j’aime la
Lettre aux Poètes. Claude Luezior est net : « Le temps n’est plus aux
poètes maudits sous leur pont […]. Que dix mille poètes prennent la
parole chaque semaine […] Avec dix grammes d’écriture, mettons le feu
au désert que l’on nous propose ».
Voilà donc un programme pour la poésie et la culture de nos jours.
Nous avons besoin de poésie, s’écrie Claude Luezior, pour gouverner et
faire avancer le monde. À lire toutes les autres lettres, surtout
celles au Rêve, au Poème, à la Patience, à « mon pauvre Fantôme ».
Claude Luezior nous lance sur la route de l’amour, de l’utopie, de la
recherche du paradis perdu. Il est un mendiant de lumière et
d’origine, dont il essaie de capter les échos. Justement, il
s’auto-définit un « passeur de feu ».
Ses mots jaillissent comme de la lave, vont en ébullition et ouvrent
le moi sur la page.
MARIO SELVAGGIO
Professeur d'Université
in : NORIA, n. 4; 08.2021 (Bari, Italie, Ed. Giovanni Dotoli)
Jusqu'à la cendre
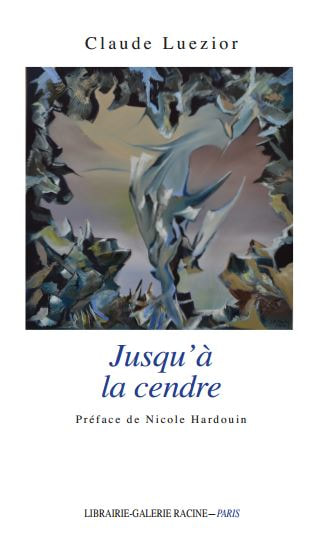
,
C'est à pas feutrés que l'on entre dans Jusqu'à la cendre, happé dès les premières pages par le courant puissant de l'écriture poétique.
Écriture précise, finement ciselée. Les mots, dont certains pénètrent en l'intime du lecteur avec une résonance intense, provoquent parfois comme une détonation...
L'alternance de poèmes et de proses confère aux textes un rythme particulier. Comme une respiration nécessaire pour aller plus avant dans le courant du fleuve.
On est entraîné, remué, secoué par cette lecture qui, évoquant des thèmes variés, est tissée autour d'une trame singulière : celle de l'humain jeté au cœur de la grande et mystérieuse Aventure, avec toute une palette d'émotions, de questionnements, d'incompréhensions, de cris et de désespoirs qu'elle ne peut que susciter. Mais aussi ces plages de douceur, de tendresse, d'amour qui s'offrent à celui qui se confronte à la merveille et à la terreur d'être humain : une épaule soutenante, un regard, des lèvres offertes... Cela, le poète le voit, le vit, le dit, au milieu de la réalité souvent douloureuse, incompréhensible et violente du monde...
Posture poétique : celle qui témoigne de la vie, de son caractère précieux et qui, en même temps, s'insurge et dénonce ce qui va à son encontre et l'avilit, la détruit. Luezior est bien dans cet acte poétique : une poignée de notes, un poème jeté dans l'espace par un geste de danse, un tableau agitant ses reflets, la main d'une femme : entre nous, un jardin premier à portée de regard.
Jean Mahler
Claude Luezior, Jusqu’à la cendre, Paris, Librairie Galerie-Racine, 2018
Claude Luezior est poète, romancier, nouvelliste, essayiste, critique littéraire suisse, professeur universitaire et médecin neurologue. Son oeuvre comprend environ 50 livres dont quelques monographies sur des peintres et artistes contemporains. Il a été recompensé de nombreux prix, dont le Prix européen de l’Association des Écrivains de Langue Française (1995), le Prix de poésie de l’Académie Française (2001), le Prix Marie Noël (2013). En 2002 il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ses poèmes se retrouvent en anthologies et revues étrangères. Il est traduit en allemand, italien, grec et roumain.
Son plus récent recueil de poèmes Jusqu’à la cendre (Paris, Librairie- Galerie Racine, 2018) alterne vers et prose poétique. La voix du poète témoigne de la solitude et de la souffrance de l’être humain dans le monde. Elle se dresse contre tout ce qui défigure son visage et fait souffrir, contre la mort sous ses multiples aspects: démence, violence, maladie, guerre, intolérance, fanatisme, contre l’oubli de l’Histoire tragique et ensanglantée, cette mémoire collective que le temps efface, permettant ainsi la restauration incessante du désarroi, de l’intolérance, de la haine qui font éclater les guerres absurdes : « chairs/ décharnées/ regards// à travers/ les pages d’Histoire/ ces visages/ me dévisagent// concentré /inhumain/ tellement humain/ de désespoir// alter ego/ que l’on massacre// au nom d’une race/ dite pure// comment prétendre/ désormais/ faire partie/ du clan homo sapiens ? »
Le poète devient le porte-parole de la douleur qui creuse corps et âmes, voués au néant. Il réfléchit et s’interroge sans cesse sur les brûlures de la vie jusqu’à la cendre, la vie anéantie par le mal et le temps, avant même de guérir ou de cicatriser ses blessures, la déchéance physique ou de l’esprit anéanti par la maladie. Que reste-t-il de nos rêves et chimères, de nos histoires de vie fauchées par les autres ou englouties par le temps dévorateur ?
Comment faire face à la « démence dépourvue de toute tolérance », aux plaies de la vie, aux cauchemars des guerres, à la solitude, à l’absence, à la conscience lucide de la dissolution de l’être? Comment combattre le mal qui ronge tout ? Des bribes de souvenirs, d’un passé attendri par l’amour, la beauté, l’amitié, eux-mêmes fragilisés par le temps jaillissent de la mémoire, avec la nostalgie d’un autre visage possible du monde : « une épaule/ peuplée de tendresse/ pour trébucher/ parfois// une épaule/ sans limite/ estuaire/ qui répare/ quilles et mats/ à la dérive. »
Il faut retenir ce vécu éphémère, avant qu’il ne s’efface définitivement de la mémoire, lui redonner corps et âme par les mots, eux-mêmes impuissants à dire l’ardeur des sentiments, la tendresse des caresses, la brûlure des blessures de l’âme, le tranchant du bistouri dans la chair souffrante, la désespérance, le cri de la vie qui ne veut pas mourir.
Il faut retrouver l’espoir et le pouvoir de renaître de la cendre comme le Phénix, refaire le bonheur de la vie, convertir les ténèbres en lumière, respirer la brise et l’aurore, se purifier dans la rosée de la nuit et la soie de l’amour d’une femme : « écarteler ce que la rouille/ vainement corrode/ déplier le doute/ et rendre braise/ à la cendre trop grise// terre labourée/ ou gémissement encore/ des vides// briser ces couteaux extrêmes/ qui se délectent/ de leurs blessures/ à l’orée des cachots/ il me faudra repeupler/ nos rêves alanguis// déplier ses paupières/ élaguer ses brumes/ violemment rendre vie/ à ses seins de porcelaine/ aux bras lourds de la nuit/ dans l’infinie fragrance/ de nos gestes inachevés. »
Le poète parle au nom d’une humanité qui a perdu sa sagesse naturelle et le lien fraternel entre les êtres vivants réunis par le même destin. Sa voix grave et satirique interroge avec amerture le sens même de liberté poussée à la déraison et à la démence criminelle des fanatiques qui ne comprennent pas qu’ils tuent sans cesse la vie, l’innocence et la beauté de l’être pour une illusion, « un arpent de terre de sable » : « guerre d’arrogances/ intimement pétries/ dans des boues aveugles// Guerre civile/ entre peuples frères/ tellement immonde/ qu’on appelle Grande// chairs tranchées/ cortège de supplices ».
Les poèmes de Claude Luezior nous offrent le kaléidoscope de la vie sous ses aspects sombres, dilués parfois par la fraîcheur et la beauté du paysage naturel autour de nous.
L’écriture, « une authentique aventure de l’esprit » reste le seul combat perpétuel contre le mal, le passage, la dissolution, la mort. Le métier du poète est bien rude : refaire par les mots le visage du monde, témoigner du vécu humain, combattre la folie des gens et la mort, faire renaître l’espoir. « Son travail est celui d’un moine-laboureur. Mains dans la glaise du langage, le poète mesure la solitude. Crues et décrues profanes. » Il « griffe le papier jusqu’à la fibre comme pour laisser une empreinte. Jusqu’au sang. »
Sonia Elvireanu, Professeure d'Université (Roumanie)
***
Clames, de Claude Luezior, éditions tituli, Paris
Article paru sur les sites Traversées et CouleursPoésies2
S’exprimer, oui ! Mais surtout surpasser la médiocrité, le vulgaire et ici c’est bien cela que notre poète aguerri et engagé clame, avant tout sortir de la fange, du cliché, du langage au rabais, du ravaudage de faubourg. Oui clamer, transmettre avec discernement et sagesse comme le barde, trouvère ou griot, restituer une signification au Verbe et hisser haut les mots.
Faire du langage un refuge protecteur, une vigie sur les chemins hasardeux de la vie. Au travers de ses « Clames » Claude Luezior dont nous connaissons depuis bien longtemps la qualité de poète « orpailleur » dont la parole fait foi, se présente à nous sous une facette nouvelle, sorte de défi oscillant entre réaction et provocation.
L’écriture se découvre à nous cadencée, rythmée, syncopée. Claude Luezior joue avec quelques subtilités de langage, sortes de jeux verbaux, sens, contresens, métaphores, mais le tout reposant toujours sur les fondations de la réflexion.
La forme tient en quelque sorte au principe du « slam » voire par extension du « rapp » mais avec l’élégance de relever le défi en l’habillant de subtilités qualitatives. Ce que ces deux nouveaux modes de vulgarisation ont souvent quelque peu oublié.
Il est indéniable que Claude Luezior se fait plaisir avec ses exercices de style riches et recherchés. Ce dernier joue de la dérision avec talent et comme un chat retombe toujours sur ses pieds. A propos de pieds, ne voyez surtout pas ici une allusion facile. Les mots coulent, s’enchaînent, se font, se défont, se heurtent, s’enlacent, s’embrassent.
En un mot, il fait de la grammaire sa petite cuisine entre impératif et subjonctif, conditionnel et inconditionnel. Il joue à saute-mouton de mots en mots, de vers en vers, le tout en l’absence de point et de virgule. Usez vous-même de votre propre ponctuation.
C’est en fait avec beaucoup de plaisir et de surprises, que nous évoluons au cœur de ce recueil, butant sur certaines formules ou nous éblouissant de son verbe. Il me semble que Claude Luezior se fasse un peu clairvoyant lorsqu’il écrit :
« Les barricades surgissent dans la ville
en enfilades
pour escouades.../... »
Sans doute ne pensait-il pas être à ce point au cœur de l’actualité :
« Le blasphème consume la ville
stratagème
suprême
qu’on essaime.../... »
Mais bien au-delà des jeux de mots, de la fantaisie, la démarche se révèle profonde car elle dénonce le monde dépersonnalisé dans lequel nous vivons actuellement, son coté éphémère et superficiel n’existant que dans l’immédiat, perdant sens et raison, la voix visionnaire du poète en amplifie l’inconsistance.
Claude Luezior ironise indéniablement, mais surtout s’insurge, hurle son dépit face au chaos d’une société se délitant, s’étiolant, face à une civilisation humaine qui sombre dangereusement vers son autodestruction :
« assez de ces brutes, assez de ces scandales, assez de ces vandales, assez des canonnades etc. etc. »
Le poète nous avertit, nous informe, il y a urgence ! Les « Clames » se font confessions, sans doute une manière de survivre en exultant poétiquement.La poésie est un combat pour l’amour qui doit fédérer le devenir de l’humanité.Afin de mieux les clamer Claude Luezior extirpe les mots de leur contexte, leur donne un sens nouveau, une vibration différente, question de survie en composant une sorte de patchwork bigarré. Il faut sortir de l’incertitude des reliques.
« Mettre le feu
Aux parcelles du rêve.../... »
Peut-être que cette néo-cryptographie est un antidote aux drames contemporains.
Poèmes parfois ludiques détenant ce mystère de la métamorphose kaléidoscopique.
Le Verbe prend aussi la forme d’un « J’accuse » face à cette société bradée et condamnée à légiférer sur des peccadilles nous détournant de la réalité. C’est clair, le poète exige une « renaissance » pour d’authentiques valeurs et une autre Liberté !
Le poète qui se veut lucide ne confondra jamais clames et clameurs, il ose le clamer !
Michel Bénard.
Lauréat de l’Académie française.
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
C'est à pas feutrés que l'on entre dans Jusqu'à la cendre, happé dès les premières pages par le courant puissant de l'écriture poétique.
Écriture précise, finement ciselée. Les mots, dont certains pénètrent en l'intime du lecteur avec une résonance intense, provoquent parfois comme une détonation...
L'alternance de poèmes et de proses confère aux textes un rythme particulier. Comme une respiration nécessaire pour aller plus avant dans le courant du fleuve.
On est entraîné, remué, secoué par cette lecture qui, évoquant des thèmes variés, est tissée autour d'une trame singulière : celle de l'humain jeté au cœur de la grande et mystérieuse Aventure, avec toute une palette d'émotions, de questionnements, d'incompréhensions, de cris et de désespoirs qu'elle ne peut que susciter. Mais aussi ces plages de douceur, de tendresse, d'amour qui s'offrent à celui qui se confronte à la merveille et à la terreur d'être humain : une épaule soutenante, un regard, des lèvres offertes... Cela, le poète le voit, le vit, le dit, au milieu de la réalité souvent douloureuse, incompréhensible et violente du monde...
Posture poétique : celle qui témoigne de la vie, de son caractère précieux et qui, en même temps, s'insurge et dénonce ce qui va à son encontre et l'avilit, la détruit. Luezior est bien dans cet acte poétique : une poignée de notes, un poème jeté dans l'espace par un geste de danse, un tableau agitant ses reflets, la main d'une femme : entre nous, un jardin premier à portée de regard.
Jean Mahler
Claude Luezior, Jusqu’à la cendre, Paris, Librairie Galerie-Racine, 2018
Claude Luezior est poète, romancier, nouvelliste, essayiste, critique littéraire suisse, professeur universitaire et médecin neurologue. Son oeuvre comprend environ 50 livres dont quelques monographies sur des peintres et artistes contemporains. Il a été recompensé de nombreux prix, dont le Prix européen de l’Association des Écrivains de Langue Française (1995), le Prix de poésie de l’Académie Française (2001), le Prix Marie Noël (2013). En 2002 il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ses poèmes se retrouvent en anthologies et revues étrangères. Il est traduit en allemand, italien, grec et roumain.
Son plus récent recueil de poèmes Jusqu’à la cendre (Paris, Librairie- Galerie Racine, 2018) alterne vers et prose poétique. La voix du poète témoigne de la solitude et de la souffrance de l’être humain dans le monde. Elle se dresse contre tout ce qui défigure son visage et fait souffrir, contre la mort sous ses multiples aspects: démence, violence, maladie, guerre, intolérance, fanatisme, contre l’oubli de l’Histoire tragique et ensanglantée, cette mémoire collective que le temps efface, permettant ainsi la restauration incessante du désarroi, de l’intolérance, de la haine qui font éclater les guerres absurdes : « chairs/ décharnées/ regards// à travers/ les pages d’Histoire/ ces visages/ me dévisagent// concentré /inhumain/ tellement humain/ de désespoir// alter ego/ que l’on massacre// au nom d’une race/ dite pure// comment prétendre/ désormais/ faire partie/ du clan homo sapiens ? »
Le poète devient le porte-parole de la douleur qui creuse corps et âmes, voués au néant. Il réfléchit et s’interroge sans cesse sur les brûlures de la vie jusqu’à la cendre, la vie anéantie par le mal et le temps, avant même de guérir ou de cicatriser ses blessures, la déchéance physique ou de l’esprit anéanti par la maladie. Que reste-t-il de nos rêves et chimères, de nos histoires de vie fauchées par les autres ou englouties par le temps dévorateur ?
Comment faire face à la « démence dépourvue de toute tolérance », aux plaies de la vie, aux cauchemars des guerres, à la solitude, à l’absence, à la conscience lucide de la dissolution de l’être? Comment combattre le mal qui ronge tout ? Des bribes de souvenirs, d’un passé attendri par l’amour, la beauté, l’amitié, eux-mêmes fragilisés par le temps jaillissent de la mémoire, avec la nostalgie d’un autre visage possible du monde : « une épaule/ peuplée de tendresse/ pour trébucher/ parfois// une épaule/ sans limite/ estuaire/ qui répare/ quilles et mats/ à la dérive. »
Il faut retenir ce vécu éphémère, avant qu’il ne s’efface définitivement de la mémoire, lui redonner corps et âme par les mots, eux-mêmes impuissants à dire l’ardeur des sentiments, la tendresse des caresses, la brûlure des blessures de l’âme, le tranchant du bistouri dans la chair souffrante, la désespérance, le cri de la vie qui ne veut pas mourir.
Il faut retrouver l’espoir et le pouvoir de renaître de la cendre comme le Phénix, refaire le bonheur de la vie, convertir les ténèbres en lumière, respirer la brise et l’aurore, se purifier dans la rosée de la nuit et la soie de l’amour d’une femme : « écarteler ce que la rouille/ vainement corrode/ déplier le doute/ et rendre braise/ à la cendre trop grise// terre labourée/ ou gémissement encore/ des vides// briser ces couteaux extrêmes/ qui se délectent/ de leurs blessures/ à l’orée des cachots/ il me faudra repeupler/ nos rêves alanguis// déplier ses paupières/ élaguer ses brumes/ violemment rendre vie/ à ses seins de porcelaine/ aux bras lourds de la nuit/ dans l’infinie fragrance/ de nos gestes inachevés. »
Le poète parle au nom d’une humanité qui a perdu sa sagesse naturelle et le lien fraternel entre les êtres vivants réunis par le même destin. Sa voix grave et satirique interroge avec amerture le sens même de liberté poussée à la déraison et à la démence criminelle des fanatiques qui ne comprennent pas qu’ils tuent sans cesse la vie, l’innocence et la beauté de l’être pour une illusion, « un arpent de terre de sable » : « guerre d’arrogances/ intimement pétries/ dans des boues aveugles// Guerre civile/ entre peuples frères/ tellement immonde/ qu’on appelle Grande// chairs tranchées/ cortège de supplices ».
Les poèmes de Claude Luezior nous offrent le kaléidoscope de la vie sous ses aspects sombres, dilués parfois par la fraîcheur et la beauté du paysage naturel autour de nous.
L’écriture, « une authentique aventure de l’esprit » reste le seul combat perpétuel contre le mal, le passage, la dissolution, la mort. Le métier du poète est bien rude : refaire par les mots le visage du monde, témoigner du vécu humain, combattre la folie des gens et la mort, faire renaître l’espoir. « Son travail est celui d’un moine-laboureur. Mains dans la glaise du langage, le poète mesure la solitude. Crues et décrues profanes. » Il « griffe le papier jusqu’à la fibre comme pour laisser une empreinte. Jusqu’au sang. »
Sonia Elvireanu, Professeure d'Université (Roumanie)
***
Clames, de Claude Luezior, éditions tituli, Paris
Article paru sur les sites Traversées et CouleursPoésies2
S’exprimer, oui ! Mais surtout surpasser la médiocrité, le vulgaire et ici c’est bien cela que notre poète aguerri et engagé clame, avant tout sortir de la fange, du cliché, du langage au rabais, du ravaudage de faubourg. Oui clamer, transmettre avec discernement et sagesse comme le barde, trouvère ou griot, restituer une signification au Verbe et hisser haut les mots.
Faire du langage un refuge protecteur, une vigie sur les chemins hasardeux de la vie. Au travers de ses « Clames » Claude Luezior dont nous connaissons depuis bien longtemps la qualité de poète « orpailleur » dont la parole fait foi, se présente à nous sous une facette nouvelle, sorte de défi oscillant entre réaction et provocation.
L’écriture se découvre à nous cadencée, rythmée, syncopée. Claude Luezior joue avec quelques subtilités de langage, sortes de jeux verbaux, sens, contresens, métaphores, mais le tout reposant toujours sur les fondations de la réflexion.
La forme tient en quelque sorte au principe du « slam » voire par extension du « rapp » mais avec l’élégance de relever le défi en l’habillant de subtilités qualitatives. Ce que ces deux nouveaux modes de vulgarisation ont souvent quelque peu oublié.
Il est indéniable que Claude Luezior se fait plaisir avec ses exercices de style riches et recherchés. Ce dernier joue de la dérision avec talent et comme un chat retombe toujours sur ses pieds. A propos de pieds, ne voyez surtout pas ici une allusion facile. Les mots coulent, s’enchaînent, se font, se défont, se heurtent, s’enlacent, s’embrassent.
En un mot, il fait de la grammaire sa petite cuisine entre impératif et subjonctif, conditionnel et inconditionnel. Il joue à saute-mouton de mots en mots, de vers en vers, le tout en l’absence de point et de virgule. Usez vous-même de votre propre ponctuation.
C’est en fait avec beaucoup de plaisir et de surprises, que nous évoluons au cœur de ce recueil, butant sur certaines formules ou nous éblouissant de son verbe. Il me semble que Claude Luezior se fasse un peu clairvoyant lorsqu’il écrit :
« Les barricades surgissent dans la ville
en enfilades
pour escouades.../... »
Sans doute ne pensait-il pas être à ce point au cœur de l’actualité :
« Le blasphème consume la ville
stratagème
suprême
qu’on essaime.../... »
Mais bien au-delà des jeux de mots, de la fantaisie, la démarche se révèle profonde car elle dénonce le monde dépersonnalisé dans lequel nous vivons actuellement, son coté éphémère et superficiel n’existant que dans l’immédiat, perdant sens et raison, la voix visionnaire du poète en amplifie l’inconsistance.
Claude Luezior ironise indéniablement, mais surtout s’insurge, hurle son dépit face au chaos d’une société se délitant, s’étiolant, face à une civilisation humaine qui sombre dangereusement vers son autodestruction :
« assez de ces brutes, assez de ces scandales, assez de ces vandales, assez des canonnades etc. etc. »
Le poète nous avertit, nous informe, il y a urgence ! Les « Clames » se font confessions, sans doute une manière de survivre en exultant poétiquement.La poésie est un combat pour l’amour qui doit fédérer le devenir de l’humanité.Afin de mieux les clamer Claude Luezior extirpe les mots de leur contexte, leur donne un sens nouveau, une vibration différente, question de survie en composant une sorte de patchwork bigarré. Il faut sortir de l’incertitude des reliques.
« Mettre le feu
Aux parcelles du rêve.../... »
Peut-être que cette néo-cryptographie est un antidote aux drames contemporains.
Poèmes parfois ludiques détenant ce mystère de la métamorphose kaléidoscopique.
Le Verbe prend aussi la forme d’un « J’accuse » face à cette société bradée et condamnée à légiférer sur des peccadilles nous détournant de la réalité. C’est clair, le poète exige une « renaissance » pour d’authentiques valeurs et une autre Liberté !
Le poète qui se veut lucide ne confondra jamais clames et clameurs, il ose le clamer !
Michel Bénard.
Lauréat de l’Académie française.
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
*
"dictionnaire.education/fr"
Mendiant - Définitions et synonymes de mendiant dans le dictionnaire français

Mendiant - Définitions et synonymes de mendiant dans le dictionnaire français
Un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumônes, ou de l’argent ou de la nourriture (...)
http://dictionnaire.education/fr/mendiant
10 LIVRES EN FRANÇAIS EN RAPPORT AVEC «MENDIANT»
(...) 2 :
Mendiant d'utopie (poésie), Claude Luezior, L'Harmattan, Paris, 2009
Sentinelle de l'espérance, Luezior centre son recueil autour de l'Amour.
3
*
Citations
Le monde de Claude Luezior est un monde vibrant où la beauté est l'un des noms de la détresse.
(JEAN-LOUIS BERNARD, in : Interventions à Haute Voix, juillet 2019)
Par la magie de sa tonalité si particulière, la cocasserie insolite de son humour et sa participation d’écorché vif à la douleur du monde, Claude Luezior nous fait sentir la matière première du bonheur. (JOELLE STAGOLL, romancière)
Les poèmes de Claude Luezior sont à la fois très humains et foisonnants d’images. (JACQUES de BOURBON BUSSET, de l’Académie française)
Claude Luezior, un écrivain humaniste qui tend à l'universel. (GEORGES SÉDIR, écrivain, Ambassadeur de France et Ministre plénipotentiaire)
Luezior est particulièrement intéressé par la symbiose avec d’autres arts. Cet écrivain tisse une œuvre au verbe haut, privilégie l’utopie et distille la lumière blanche en ses composantes de couleurs spectrales (...) Lauréat de nombreux prix, Claude Luezior a marqué magistralement son territoire en littérature. (JEAN DESMEUZES, écrivain, inspecteur d’Académie, lauréat en 1964 du Prix Apollinaire -que l’on appelle souvent le Goncourt de la Poésie-)
L’œuvre littéraire de certains médecins est souvent inspirée par les émotions, les réflexions suscitées par leurs expériences ou nées au chevet des malades qu’ils traitent. Tel fut Tchekhov, tel est Claude Luezior. (JEAN BERNARD, écrivain, membre de l’Académie française, ancien Président de l’Académie des Sciences)
Avec une prodigieuse adresse, Luezior mêle des citations du peintre Armand Niquille à ses propres lignes. Le résultat comblera le lecteur et l’amateur d’art satisfaits de rencontrer un artiste « figuratif mais onirique, éminemment courtois mais habillé de solitude » que sert lucidement, ardemment un écrivain de talent. (PAULE D’ARX, docteur ès lettres, critique littéraire)
MANOS STEPHANIDIS, professeur à la Sorbonne a longuement présenté au musée Bénaki à Athènes le livre d’art (bilingue, franco-grec) « De l’oxydo-gravure à la mythologie des mots », fruit d’une complicité entre le peintre Guy Breniaux et Claude Luezior talentueux homme de plume, auteur d’une vingtaine d’ouvrages. (DANIEL GREUZARD, critique d’art, Le Progrès de Lyon, 22.12.2003)
"À pleines mains" : une belle réussite dans l’art de maîtriser un style concis. (LE MONDE DES LIVRES, 24.05.1996)
Pas une page qui n’offre la dimension de la verticalité. (PIERRE GREMAUD, écrivain, homme de théâtre, critique)
Poète à l’écriture dense, il ne cesse de rechercher cette alchimie des mots qui remue le meilleur au tréfonds du lecteur. Luezior est en quelque sorte un visionnaire balancé entre le sensuel et l’esprit, avec un parfum d’ascétisme. (CLAUDE EVRARD-COUPIC, écrivain, éditorialiste)
On ne lit pas ses romans : on y entre tout doucement en faisant grincer les gongs de la porte et craquer le parquet, puis on se laisse entraîner par la douceur de la fulgurance d’une histoire, racontée, parfois chuchotée par un conteur qui semble connaître les mille et un rouages de la complexe et mystérieuse mécanique humaine. Comme dans un ciel tourmenté, il arrive à vous offrir, l’espace d’un instant, un morceau de ciel bleu. Là, au gré des pages se cache, dans l’écrin de la narration, la vérité des mots. (...) ″ Claude Luezior, nouvelliste, romancier et poète a tracé une œuvre féconde où la finesse et la précision du verbe enchantent le lecteur. ″ (LAURENT BAYART, écrivain, 1er éditeur français de W. Szymborska, Prix Nobel de littérature 1996 ; Co-rédacteur en chef de la Revue Alsacienne de Littérature (RAL), Strasbourg)
C’est que dans l’écriture de Claude Luezior œuvrent les tendresses du regard. Dans l’empathie de la voix narrative, la vie s’obstine et chante. (JEAN-DOMINIQUE HUMBERT, écrivain, critique, red. en chef adj. Coopération).
Pavlina possède les métaphores de l’image révélée, Claude Luezior réinvente la transfiguration du verbe. (MICHEL BENARD, écrivain, chevalier des Arts et des Lettres, lauréat de l’Académie française)
Luezior a des formules heureuses. Ce voyage (« Impatiences ») est un hymne tendre et poétique à la vie. (ANDRÉE FERRIER-MAYAN, docteur ès lettres, rev. litt. « Sud », Marseille)
″Fruit de nos désirs" : c’est là que le miracle de la poésie opère. Une prose riche au service de courts versets, qui explore tout l’univers des possibles, qui nous fait découvrir, brique après brique, étape après étape, toute l’édification de ce qu’est l’être humain. (LOUIS DELORME, écrivain, lauréat de l’Académie française, Officier des Palmes académiques)
Poésie en vers libres, sans points ni virgules. On devrait dire poésie naturelle ou du Naturel. En ses confins cosmiques, bien réussie, elle est aussi exacte qu’une poésie classique achevée. (CHARLES P. MARIE, professeur aux universités de Bradford et Coventry)
J’aime beaucoup l’écriture de Luezior et suis prêt à la publier.(MICHEL COSEM, Prix Renaudot pour la jeunesse 2002, Editeur d’Encres Vives, 2011)
L’on ne se lasse pas de contempler les peintures de Pavlina éclairées par l’immense talent de Claude Luezior tout au long de cette promenade humaniste, rêveuse ou métaphysique. (LAURENCE MORECHAND, docteur ès lettres, anc. rédactrice en chef de Femmes artistes international)
Ses phrases nous donnent à voir ce qu’est l’écriture, la vraie, celle d’un des tout premiers stylistes contemporains. (JEAN-LOUIS BERNARD, poète et critique littéraire ; in : Pages insulaires, sept. 2012)
Claude Luezior a bien compris l'urgence de sa voie poétique en brûlant ses mots dans le fût de sa plume... les mots toxiques, pris au collet, ravisseurs ou câlins à l'étreinte charnelle. (YOLAINE et STEPHEN BLANCHARD,
in : Ces douleurs mises à feu, 2015
Les opposés, qui ne viennent pas nécessairement en coïncidence, et les paradoxes de la vie qui, à la fois se multiplie et s’auto-détruit, sont comme le sang des poèmes de Claude Luezior. Aucune facilité, aucune dérobade, aucun contournement, le choc du vivant qui ne cesse, de réplique en réplique, de s’étendre.
Rémi Boyer, 2019 in https://incoherism.wordpress.com/
*
Autres articles et extraits
Chemin de rêves de Claude Luezior
in : Fribourg Illustré (ACM éd. Strasbourg)
***
Par ailleurs, Chemin de rêves en e-book chez France Loisirs :
9782402022606.htmlwww.franceloisirs.com/poesie/chemin-de-reves-9782402022606.html
in : Fribourg Illustré (ACM éd. Strasbourg)
***
Par ailleurs, Chemin de rêves en e-book chez France Loisirs :
9782402022606.htmlwww.franceloisirs.com/poesie/chemin-de-reves-9782402022606.html
CLAMES, Poèmes à dire, CLAUDE LUEZIOR, ÉDITIONS TITULI, Paris. 2017
Mais quel est donc ce nouveau daïmon qui enfièvre Luezior ? En effet, dans tous les recueils précédents, l’auteur, avec son sens inné de l’image, est oiseleur qui, dans des plissés de douceur, origine des houles de rêve.
Glaneur d’arc-en-ciel, entre vacillements de cierges et odeurs d’encens, il bat les cartes d’un jeu de songes dans des bourrasques de sensualité et s’avance à pas de chartreux. Ici, dans Clames, on est de prime abord surpris, voire interloqué, devant ce choc des mots que le poète martèle avec un bonheur évident et heureux : elle / disloque / croque / escroque / révoque.
Les phrases courtes, réduites au maximum. Elles sont des coups de gond qui résonnent, des coups de poing qui font des bleus à la voix car, instinctivement, comme à l’écoute d’un slam on se laisse emporter par ce rythme : ici pulse le besoin du dire Sabre au clair, les mots en débord moissonnent le souffle, sortent de la page. Le lecteur devient orateur, il scande : coupe / mes coups de sang / coupe mes poignes / découvre ta croupe.
C’est une armée au pas de charge qui sonne la diane, dévale les pentes du livre et monte à l’assaut de celui qui lit : je heurte / Parce que je suis heurtoir et m’agenouille/ sombre fripouille / à l’échancrure des souvenances (…) et je heurte / heurte sans tympan / et je heurte / jusqu’au sang.
Mots qui fustigent, fouettent : assez / de ces scandales / de ces vandales / qui empalent mes vestales. Mots volcans, lave sur les dérives du quotidien : c’est clair / les bijoux / de pacotille / transpercent / les chairs (…) se faire marquer : comme si l’on n’avait / pas asse tatoué / les suppliciés / aux camps / des condamnés. Mots guillotines : c’est clair / on a proclamé : les déchets / œuvre d’art / et les détritus / sur fonds sprayés / sont glorioles / pour discours / esthétisés.
Malgré soi, par la puissance de ce dire, on s’enrôle dans la troupe marche. Et soudain, ici et là, quand on s’y attend le moins, lorsque le vent s’apaise, Luezior pose son bivouac pour se laisser glisser : peut-être le temps est venu, le temps où l’on respire d’autres rêves. Le poète passionné ouvre sa besace. À la lumière d’un phare lointain, une sirène passe : il rêve d’écailles et filtre une confidence aux yeux de salamandre : Ne t’en déplaise / j’aimerai / seul sous la treille / l’ombre de tes soleils / j’aimerai tes vermeils.
Dans sa nuit, les étoiles laissent glisser l’humour : à la fripe / j’ai mis / quelques reliques / de participes / trop passés. Dans la fragilité de ses chimères, il déploie les ailes des libellules au tulle de ses pensées, il sait qu’une lueur pointe toujours au-delà du noir. Entre un nuage et une ombre, disons avec le chantre : buvez / comme le rouge-gorge / buvez / de vos lèvres / jusqu’à ce que vie / s’en suive / et surtout / buvez- moi.
Claude Luezior est à la fois marbre et sculpteur, il incendie ses vaisseaux avec élégance, parfois à contre-courant mais jamais à contre-cœur, il écrit sur le sable mouvant de la vie avec joie et douleur : dialogue avec l’ange, mais aussi dialogue avec ces riens tantôt sublimes, tantôt insalubres. Gênes de sang au calice de l’offrande.
Avec le poète clamons ses « Clames » au miroir / du puits / où culbutent / nos songes. Pour mémoire, les éditions tituli ont sorti en 2016 Une dernière brassée de lettres du même auteur.
© Nicole Hardouin in : Traversées
Poésie et images pour la cathédrale de Fribourg et ses mystères
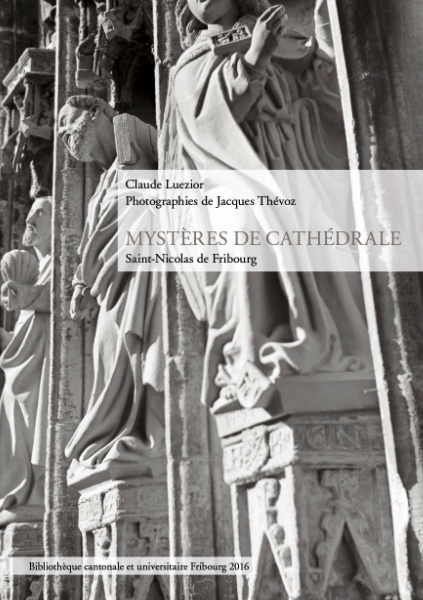
Une cathédrale dans une petite ville, Fribourg, et des impressions en cascade, la photo épaulant le texte - ou le contraire. C'est le bonheur de lecture que réserve "Mystères de cathédrale", un beau livre aux allures rétro signé conjointement par Jacques Thévoz, le photographe, et par Claude Luezior, le poète. Ils ne se sont pas connus, certes - question de génération. Mais leurs oeuvres se sont rencontrées et mises au diapason dans cet ouvrage publié en toute fin d'année 2016 par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.
Les photographies en noir et blanc de Jacques Thévoz sont splendides, disons-le d'emblée. Il arrive qu'elles fixent une géométrie particulière, ou donnent à voir ce que le visiteur distrait de la cathédrale n'aura qu'effleuré - dans le meilleur des cas: des détails de vitraux, des statues, des éléments du mobilier liturgique.
Elles savent aussi montrer l'humain, plongé dans les rituels de la religion catholique, pratiquée avec ferveur. Souvent, les prises de vue soulignent la gravité de ces instants religieux, souvent empesés et graves, qui ont rythmé la vie des Fribourgeois jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On y reconnaît quelques visages, à l'instar de l'organiste Joseph Gogniat. On y repense avec nostalgie aux funérailles de l'abbé compositeur Joseph Bovet.
En contrepoint, le poète Claude Luezior pose ses propres mots sur la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Son regard est actuel. Il complète ce que le photographe a immortalisé. On y trouvera donc les allusions aux derniers enrichissements de la cathédrale, montrés comme le prolongement d'une oeuvre architecturale inachevée: les vitraux d'Alfred Manessier sont observés de près, faisant écho aux vitraux historiques de Józef Mehoffer, "le Klimt polonais". Chaque chapitre capte un élément des lieux, invitant l'habitué à lever les yeux sur des choses qu'il ne voit plus à force de les côtoyer.
Les textes de Claude Luezior sont de temps à autre dans l'anecdote ou la légende surprenante, par exemple lorsqu'il est question du creusement de la molasse au-dessous de l'édifice, pour en faire quelque chose de grand malgré tout. Ils relèvent du registre du souvenir, travaillé pour sonner juste et précieux pour le lecteur, quand il faut évoquer des rituels tels que la Madone des Centaures (comprenez: les motards!) ou le temps fort de la Saint-Nicolas.
Quel saint Nicolas, d'ailleurs? L'auteur ne manque pas de rapprocher Saint Nicolas de Flüe, personnage clé de l'histoire suisse, et Saint Nicolas de Myre, saint patron de la cathédrale, ni de révéler, astucieux, leur place respective dans la cathédrale. Il y a enfin un soupçon de facétie lorsqu'il est question d'évoquer la chaire, les brûle-cierges et les confessionnaux en déshérence...
Si "Mystères de cathédrale" montre avec brio ce que la cathédrale de Fribourg a d'unique et d'exceptionnel, ce livre ne se limite pas à une approche impressionniste qui pourrait paraître floue. Au contraire: l'ouvrage est fortement documenté, puisant ses sources dans des articles rares. Ces recherches révèlent à l'érudit que l'édifice trouve sa place dans le réseau des cathédrales gothiques du Moyen Age, puis s'est en permanence enrichi, grâce à ses beautés architecturales ultérieures (autels baroques, reliques) comme aux humains qui l'ont fait vivre.
Jacques Thévoz et Claude Luezior se sont ainsi associés pour offrir au public un regard précieux, témoin par-delà les ans, de ce qu'est la cathédrale de Fribourg aujourd'hui, monument incontournable et somme de ce que les gens d'ici et d'ailleurs lui ont donné.
FATTORIUS (Daniel Fattore) mars 2017
http://fattorius.blogspot.ch/2017/03/poesie-et-images-pour-la-cathedrale-de.html
Claude Luezior, Jacques Thévoz, Mystères de cathédrale, Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire, 4e trim. 2016.
Cathédrale St-Nicolas de Fribourg / Suisse

Cliquer ici pour modifier.
Fonds Jacques Thévoz, Bibliothèque Cantonale et Universitaire Fribourg : Mystères de cathédrale St-Nicolas de Fribourg, C. Luezior, BCU, 2016
Xavier Schaller
MYSTÈRES DE CATHÉDRALE Saint Nicolas de Fribourg - Claude LUEZIOR - photographies : Jacques THÉVOZ
Ce nouvel ouvrage de Claude Luezior achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie de Saint Paul à Fribourg en novembre 2016 est un livre d'Art en noir et blanc, d'une sobre beauté. Il est publié sous l'égide de l'institution patrimoniale de la B.C.U (Bibliothèque Cantonale et Universitaire). Son format allongé inhabituel : 16/27 permet de rendre compte de la verticalité en perspective de la cathédrale avec vue partielle des sculptures alignées sur son fronton. Il s'agit d'un livre d'Art et de Poésie où Claude Luezior, avec l'humour tendre, l'émotion et la finesse d'observation qu'on lui connaît, nous fait une description attentive de l'édifice fragile de quartz et d'argile qui se délite au fil des années tout en affrontant les siècles dans la beauté humaine de la foi.
L'auteur nous prend donc par la main, nous invite à le suivre, se propose, lui qui est dans la connivence avec le lieu, de nous servir de guide afin que nous ressentions la force de permanence de cette cathédrale ''fière de ses arches et de ses voûtes, orgueilleuse de ses turbulences minérales''... car ''Menuet de poussière, elle demeure, contre vents et acides, roc d'espérance''. Cet édifice a été maintes fois représenté par le peintre Armand Niquille ce qui a d'ailleurs inspiré à Claude Luezior sa magnifique monographie : ''Niquille, maître de lumière".
Au fil de la visite, Claude Luezior citera toutes les confréries, les compagnonnages, les artisans d'exception comme le verrier Josef Mehoffer (le Klimt polonais) ainsi qu'Alfred Manessier pour la réalisation du somptueux vitrail moderne du Saint Sépulcre. Il nous fera vivre la cathédrale au rythme des fêtes joyeuses de la Saint Nicolas qui unissent le peuple de Fribourg et ses alentours, élans suivis du recueillement qui accompagne les deuils et les guerres …
Nous pouvons suivre la visite de la cathédrale, à livre ouvert comme un saint livre que l'on consulterait au long d'une procession aux nombreuses stations, en écoutant la voix de l'auteur.
Quelques extraits :
La tour et sa légende :
"Tout en haut une volée de cloches, dont les battants rythment les pulsations du pays''...oiseaux et congères y font leur nid...Vous y rencontrerez... Descendez maintenant, descendez encore, prenez en catimini le deuxième escalier... dans les enfers des soubassements..."
Nef :
Bagués d'or, les chapiteaux convergent à l'unisson des prières. Stupéfiantes fiançailles... pour un grand corps en majesté.
Portail occidental :
Achetez le programme ! Mais prenez garde, la bande-annonce théologique n'est pas faite pour des enfants de choeur... elle oppose diables jouissifs et docteurs de l'église...
Bénitier :
Certains se signent, pressés comme pour pointer à l'horodateur du Seigneur... s'avance la bigote à la peau parcheminée : marathonienne de la rédemption...
Grilles du choeur :
"Je reste accroché à cette grille dont les losanges marquent mes paumes. Gueux en quête de miracle... La communion est mot féminin, chair du partage. Elle me console. Elle s'est agenouillée, tout près de moi''
Grandes orgues :
Nous voici dans l'oeuvre sacrificielle du Grand orage, dans la tourmente de Dieu.
Tout à coup, tandis que refluent les grondements telluriques, renaît un silence, lavé de tout péché.
Nous laisserons le lecteur-visiteur suivre le reste des stations de ce haut lieu où ''de la pierre crue monte une respiration... parmi les sacrements d'une dynastie de colombes''
Jeanne CHAMPEL GRENIER
Read more at http://www.jeannechampelgrenier.com/pages/liens/claude-luezior-ecrivain.html#Cowr4ReYtJ2AdfSi.99
Claude Luezior : Pavlina : espaces et transparences
Editions du Tricorne, Genève

.
Franchir la frontière entre le charnel et le mystique, changer de corps touchent au plaisir, à la jouissance comme aux possibilités d’angoisse puisque les certitudes se voient interpellées par cette traversée. Pavlina ne cesse de la rappeler. Quant au poète Luezior, il ponctue en orpailleur les fontaines de jouvence de l’artiste. Pour ses personnages, à l'« aveuglement » de l'amour, répond une attente exaspérée, désespérée. La Vaudoise les montre en instance de purification comme au prise avec le miel charnel.
Luezior rappelle que la voyageuse de l'amour ne fait qu’emmener avec elle ses propres bagages, son propre inconscient : si bien que chaque toile devient un lieu de réclusion qui fascine néanmoins le poète charmé par les « femmes-lumières ». Son texte en fragments invite à franchir « à rebours » le seuil de l’œuvre où la femme reste sainte et pécheresse. A son évasion impossible répond la pénétration du regard en un lieu qui n’est plus à l’extérieur d’une frontière mais dedans.
Pavlina y accomplit une avancée vers quelque chose qui n’a plus rien à voir avec un charme de la nudité mais avec un dépouillement. A l’étrangeté éruptive, à l’attrait volcanique de l’amour humain répond un retournement mystique. Ce bond permet à l’inconscient qui habituellement ne connaît pas la traversée des frontières d’être mis en connexion avec ce qui le dérange.
Une telle expérience ne peut laisser indemne puisque le saut et l'éclat des œuvres de Pavlina, comme le souligne Luezior, crée un transfert. Il désaxe des assises, des sécurités voire du sens même de désir. Dès lors celles qui restent les Enceintes de l'Amour et n’arrivent pas à venir à bout du cerclage parviennent néanmoins à franchir la frontière interne de l’être.
Chaque toile permet de « survivre aux entrailles » en devenant « le témoin de la terre » (Nicole Hardouin) où l’être tel Roland à Roncevaux joue à saute-mouton au bord des gouffres, espérant une brèche, là où il est en quête d’un corps qui doit se quitter et du cor qui lui permet de s’ouvrir à l’altérité suprême, l’extrême transparence de la source première.
Jean-Paul Gavard-Perret
In : De l'art helvétique contemporain
24heures : Rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse romande
***
Armand Niquille
"Le monde renaîtra de la destruction, de l'absurdité et de l'orgueil", tempéra sur panneau, 114 x 162 cm, 1944.
"Le monde renaîtra de la destruction, de l'absurdité et de l'orgueil", tempéra sur panneau, 114 x 162 cm, 1944.

Claude LUEZIOR : ARMAND NIQUILLE, artiste-peintre au cœur des cicatrices, Éditions de l’Hèbe, 2015
Dans cette biographie romancée de Armand Niquille, l’écrivain Claude Luezior fait vivre de manière passionnante le parcours singulier de ce peintre hors cadres mais aussi celui de ses ancêtres et leurs implications dans l’Histoire de France. Biographie car tous les éléments et références se veulent exactes, romancée de part certains dialogues imaginaires tracés dans le respect de la personnalité de l’artiste-peintre que Luezior a personnellement connu.
Dès sa prime enfance, Niquille, Petit Chose torturé se pose de lancinantes questions ; « suis-je vraiment le fils d’un conducteur de trams ? Pourquoi ma mère a-t-elle louée une petite épicerie au lieu de rester lingère au château ? » Le doute reste momentanément sans réponse : là, explique C. Luezior, se trouve le ferment de sa souffrance, la racine de son œuvre riche de plus de mille toiles.
L’enfant entend dans l’épicerie maternelle des allusions émises par de charitables commères, les interrogations persistent face au mutisme de sa mère jusqu’au jour où, dans une exposition de peinture, il va rencontrer une sorte de dandy qui lui-même s’essaie à l’art. Face à face, âme contre âme, ils se découvrent ; « même regard, même maintien altier, ils sont semblables. »Niquille a vingt ans, il comprend. Intuitivement ils se sont reconnus, Fred de Diesbach, le fils du comte Raoul est son demi-frère dont il deviendra l’ami. Il fera des visites au château dans l’atelier du peintre, sans jamais croiser le regard de l’aigle Raoul : le puissant comte de Diesbach, son père. A de multiples reprises, ils peindront l’allée du château, les arbres de Niquille seront noueux, torturés, ceux du fils légitime, bien droits. Le Banni Magnifique, selon l’expression du critique J.P Gavard-Perret, signera parfois ses toiles Nihil (rien).
Jamais Niquille ne revendiquera quoique ce soit. Malgré ses cicatrices, il veut rester grand et puissant par la magie de sa peinture.
L’ouvrage rédigé d’une plume enlevée a plusieurs facettes dont un large pan historique : en effet, parmi les ascendants de l’homme au béret on trouve Nicolas de Diesbach, chambellan à la cour du roi Louis XI. A la tête des bernois, alors puissance militaire majeure, Nicolas s’allia à d’autres troupes pour battre le puissant duc de Bourgogne : Charles. le Téméraire qui fut défait aux batailles de Grandson, Morat et Nancy : le très habile Louis XI récupéra ainsi la Grande Bourgogne.
Autre volet historique important lié à Niquile ; nous sommes pendant la seconde guerre mondiale : censure et cruel manque de papier à Paris. Claudel, Mauriac, P. Emmanuel, P. Jean Jouve et d’autres écrivains se retrouvent à Fribourg où ils vont faire éditer plusieurs de leurs manuscrits. Déambulent également dans ce creuset Giacometti et Balthus. Armand, malgré sa nature sauvage baigne dans ce milieu. Il se lie d’amitié avec Balthus.
Malgré ces influences, Niquille reste un solitaire, trace son sillon quasi-monacal dans son atelier. Là il enchaîne ses cathédrales comme Monet pour celle de Rouen, il la peindra cent fois,met en perspective vierges et anges, arbres toujours noueux, taillés à l’instar de sa propre souffrance, s’attarde sur Fribourg. Il crucifie son âme sur de multiples Golgotha.
Niquille est un humaniste, un mystique, il baigne dans une lumière crucifère, toujours en recherche de la verticalité, de la transcendance. Fuyant les coteries, les petits fours, il reste à Fribourg à la recherche de l’essentiel, humble à l’extrême : je ne suis qu’un artisan au pied de la croix. Ce retrait volontaire l’a empêché d’avoir une dimension internationale.
Pendant tout ce temps à Paris, une jeune femme se pose curieusement les mêmes interrogations que Niquille : enfant, sa grand-mère était aussi lingère au château, quarante années les séparent. Elle ne comprend pas : Fribourg, le couvent parisien, le jardinier pervers, les religieuses silencieuses… mais nous laissons au lecteur le soin de découvrir sa quête si bien restituée par C. Luezior.
Dans ce roman écrit avec une plume talentueuse, on retrouve la passion de Luezior pour l’histoire franco-suisse et l’empathie pour cet homme ordonné artiste par un chartreux. Là, se mêlent rigueur et foisonnement, or et sang, avec au centre Niquille, géant de l’ombre, peintre et poète, byzantin et flamand.
Roman à lire avec intérêt et bonheur.
© Nicole Hardouin
in : Traversées, oct. 2015
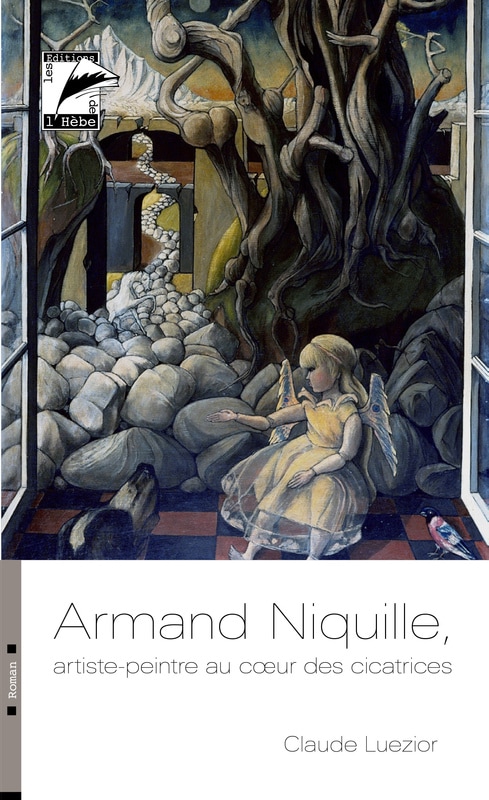
Cliquer ici pour modifier.
Niquille le banni magnifique
Claude Luezior, « Armand Niquille, artiste-peintre au cœur des cicatrices », Editions de l’Hèbe, 2015. « Armand Niquille de Fribourg à Charney », Musée de Charney, du 11 octobre au 20 novembre 2015.
En un de ses derniers textes poétiques, Luezior qui fut l’élève admiratif puis l’un des amis proches du peintre,disait déjà beaucoup sur l’importance d’Armand Niquille. Pour l’auteur, dans ses aubes stellaires l’artiste dévoilait « ses architectures messianiques / intemporelles / partitions / pour druides / qui parachèvent / les fantasmes / d’un cosmos / intime ». Dans son roman vrai le poète de Fribourg développe les dédales existentiels de l’artiste au sein de son existence. Armand Niquille né en 1912 n’a cessé de peindre Fribourg sa ville natale. Il en tire ce que l’essayiste nomme « la poésie du lieu et la poétique de Dieu ». Il complète sa vision urbaine de sujet plus humbles, d’œuvres religieuses, des natures mortes et des compositions où s’accordent symbolique et imaginaire sans se départir de solennité.
Le trajet de l’artiste ne fut pas simple : refoulé du château de son père (en tant que fuit adultérin), caillassé par des gamins au nom pourtant de cette paternité lointaine il resta habité par la peinture même s’il la signa un temps du simple mot latin « Nihil »…
Celui que la poétesse Nicole Hardouin nomme « le méconnu christique » renvoie l’art vers une réversion figurale loin de la logique habituelle du repli imaginaire. Son œuvre devint pourtant un véritable lieu “ morphogénétique ” sous la forme de totems urbains plus ou moins héritiers du château paternel mais aussi de rêves d’un « baron perché ». Leur nature symbolique et anthropomorphique crée une iconographie particulière. Elle ne porte plus aucunement à une quelconque gloire céleste de l’image. L’artiste remplace la dévotion médiévale et ses représentations de connivence par des structures qui font chavirer l’aspect ornemental sous l’effet de charge qui exalte la vie (terrestre ou non) au sein d’une violence sourde. Une telle approche évacue tout maniérisme afin d’extraire le regard dévot qu’on accorde à l'art afin de le remplacer par un regard plus sacrificiel vers ce qui à la fois devient nocturne et enflammé.
Jean-Paul Gavard-Perret
24 10 2015
in : De l'art helvétique contemporain : rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse
Niquille le banni magnifique
Claude Luezior, « Armand Niquille, artiste-peintre au cœur des cicatrices », Editions de l’Hèbe, 2015. « Armand Niquille de Fribourg à Charney », Musée de Charney, du 11 octobre au 20 novembre 2015.
En un de ses derniers textes poétiques, Luezior qui fut l’élève admiratif puis l’un des amis proches du peintre,disait déjà beaucoup sur l’importance d’Armand Niquille. Pour l’auteur, dans ses aubes stellaires l’artiste dévoilait « ses architectures messianiques / intemporelles / partitions / pour druides / qui parachèvent / les fantasmes / d’un cosmos / intime ». Dans son roman vrai le poète de Fribourg développe les dédales existentiels de l’artiste au sein de son existence. Armand Niquille né en 1912 n’a cessé de peindre Fribourg sa ville natale. Il en tire ce que l’essayiste nomme « la poésie du lieu et la poétique de Dieu ». Il complète sa vision urbaine de sujet plus humbles, d’œuvres religieuses, des natures mortes et des compositions où s’accordent symbolique et imaginaire sans se départir de solennité.
Le trajet de l’artiste ne fut pas simple : refoulé du château de son père (en tant que fuit adultérin), caillassé par des gamins au nom pourtant de cette paternité lointaine il resta habité par la peinture même s’il la signa un temps du simple mot latin « Nihil »…
Celui que la poétesse Nicole Hardouin nomme « le méconnu christique » renvoie l’art vers une réversion figurale loin de la logique habituelle du repli imaginaire. Son œuvre devint pourtant un véritable lieu “ morphogénétique ” sous la forme de totems urbains plus ou moins héritiers du château paternel mais aussi de rêves d’un « baron perché ». Leur nature symbolique et anthropomorphique crée une iconographie particulière. Elle ne porte plus aucunement à une quelconque gloire céleste de l’image. L’artiste remplace la dévotion médiévale et ses représentations de connivence par des structures qui font chavirer l’aspect ornemental sous l’effet de charge qui exalte la vie (terrestre ou non) au sein d’une violence sourde. Une telle approche évacue tout maniérisme afin d’extraire le regard dévot qu’on accorde à l'art afin de le remplacer par un regard plus sacrificiel vers ce qui à la fois devient nocturne et enflammé.
Jean-Paul Gavard-Perret
24 10 2015
in : De l'art helvétique contemporain : rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse
"Le mythographe", huile sur bois, 32 x 48 cm, 1959 : autoportrait d'Armand Niquille
Armand Niquille, artiste-peintre au cœur des cicatrices, roman,
Claude Luezior, Editions de l’Hèbe, 2015
C’est spécifié en tout petit sur la tranche du livre : roman, mais le dernier opus de Claude Luezior s’apparente plus à une méticuleuse biographie, au travail historique fouillé, qu’à une entreprise romanesque même si l’écriture – très littéraire et poétique – habille la rigueur d’un zeste de fantaisie. Le narrateur connaît bien son sujet (terme approprié !) car il fut l’élève devenu ami d’Armand Niquille, ce grand peintre fribourgeois (1912-1996), figure emblématique avec son béret mythique.
La vie de cet artiste est hors-norme, suscitant déjà l’imaginaire, voire la fiction, personnage de roman que Luezior installe fort logiquement dans ses pages. Hommage et admiration à l’adresse de ce peintre majeur, issu de rien, qui signa même parfois ses œuvres d’un surprenant Nihil. Ce presque récit est basé sur des entretiens, rencontres, documents, témoignages, souvenirs et surtout l’amitié que nourrissait Claude Luezior envers cet artiste. Celui-ci produisit des nus, portraits, natures mortes, allégories et scènes mystiques mais aussi ses Fribourg qui prirent une place considérable dans l’espace culturel de cette ville. Ainsi peigna-t-il plus d’une centaine de fois sa magnifique cathédrale, à l’instar d’un Claude Monet à Rouen.
Les deux cent cinquante pages du volume s’effeuillent passionnément car Luezior – en guide avisé – nous raconte la singulière histoire de ce génie en son atelier et sage dans sa caverne de philosophe. Destin en secret de famille : en effet, Armand Niquille n’est-il pas le fils d’un obscur conducteur de tram dévoré par la tuberculose ou fils, d’une lingère qui, comme cette Charlotte trop féconde, a perdu son travail au Château ? L’improbable géniteur – roitelet des lieux – détroussa plus d’une soubrette…
Et voilà que le destin se pare de blasons et autres enluminures qui ne disent pas leurs noms… Ouvrage d’une existence qui se lit comme un roman, vous avait-on dit… Ainsi rencontrera-t-il ce demi-frère avec lequel il peindra en cachette, tels des potaches à la maraude. Les existences se croisent et se trouvent de génétiques connivences…
Mais il ne faudrait pas oublier l’auteur de ce livre (fribourgeois de surcroît) qui est aussi le chantre de cette cité dont il nous apprend – l’historien se cache derrière la double silhouette de l’écrivain et du médecin – qu’elle s’appelait jadis Nuithonie (nom ancien et charmant pour Fribourg) et qu’elle fut un véritable fleuron, centre d’activités intellectuelles et littéraires durant la Seconde Guerre Mondiale. Ceci grâce à l’éditeur Walter Egloff qui publia – excusez du peu – quelques grosses pointures de l’écriture dont Mauriac, Claudel, Aragon, Maritain…et même un certain Charles de Gaulle qui confiera trois manuscrits à la Libraire Universelle de France (LUF), sise à Paris mais issue de Fribourg !
Bref, la ville fut un creuset dont beaucoup ignorent l’importance qu’elle avait à cette époque. Et notre cicérone à moustaches, pipe au bec, de rappeler aux touristes lambda que la Saint-Nicolas est également une fête qui rassemble chaque année, les Fribourgeois par dizaines de milliers, comme quoi l’histoire et les traditions séculaires sont intimement mêlées sur les bords de la Sarine, aux reliefs escarpés de molasse, prenant vie en cascades médiévales.
A l’arrivée, ce livre pose un regard érudit et tendre sur un grand artiste contemporain qui, plutôt que de se dire artiste, se voulait œuvrant. Il retrace fidèlement le parcours d’Armand Niquille dont le destin se confond avec cette pittoresque ville qu’est Fribourg.
Quelque part, outre l’hommage rendu au peintre, c’est aussi cette ville suisse qu’il aime par-dessous tout que célèbre Claude Luezior, l’écrivain inspiré de ces terres pentues, dont Niquille dit que l’esprit étriqué de ce pays si complexe, c’est ce qui le sauve. Il en est parfois de même de la stature des artistes…
Laurent BAYART
in : Revue alsacienne de littérature (RAL),
Strasbourg, 2016
*
Claude Luezior, Editions de l’Hèbe, 2015
C’est spécifié en tout petit sur la tranche du livre : roman, mais le dernier opus de Claude Luezior s’apparente plus à une méticuleuse biographie, au travail historique fouillé, qu’à une entreprise romanesque même si l’écriture – très littéraire et poétique – habille la rigueur d’un zeste de fantaisie. Le narrateur connaît bien son sujet (terme approprié !) car il fut l’élève devenu ami d’Armand Niquille, ce grand peintre fribourgeois (1912-1996), figure emblématique avec son béret mythique.
La vie de cet artiste est hors-norme, suscitant déjà l’imaginaire, voire la fiction, personnage de roman que Luezior installe fort logiquement dans ses pages. Hommage et admiration à l’adresse de ce peintre majeur, issu de rien, qui signa même parfois ses œuvres d’un surprenant Nihil. Ce presque récit est basé sur des entretiens, rencontres, documents, témoignages, souvenirs et surtout l’amitié que nourrissait Claude Luezior envers cet artiste. Celui-ci produisit des nus, portraits, natures mortes, allégories et scènes mystiques mais aussi ses Fribourg qui prirent une place considérable dans l’espace culturel de cette ville. Ainsi peigna-t-il plus d’une centaine de fois sa magnifique cathédrale, à l’instar d’un Claude Monet à Rouen.
Les deux cent cinquante pages du volume s’effeuillent passionnément car Luezior – en guide avisé – nous raconte la singulière histoire de ce génie en son atelier et sage dans sa caverne de philosophe. Destin en secret de famille : en effet, Armand Niquille n’est-il pas le fils d’un obscur conducteur de tram dévoré par la tuberculose ou fils, d’une lingère qui, comme cette Charlotte trop féconde, a perdu son travail au Château ? L’improbable géniteur – roitelet des lieux – détroussa plus d’une soubrette…
Et voilà que le destin se pare de blasons et autres enluminures qui ne disent pas leurs noms… Ouvrage d’une existence qui se lit comme un roman, vous avait-on dit… Ainsi rencontrera-t-il ce demi-frère avec lequel il peindra en cachette, tels des potaches à la maraude. Les existences se croisent et se trouvent de génétiques connivences…
Mais il ne faudrait pas oublier l’auteur de ce livre (fribourgeois de surcroît) qui est aussi le chantre de cette cité dont il nous apprend – l’historien se cache derrière la double silhouette de l’écrivain et du médecin – qu’elle s’appelait jadis Nuithonie (nom ancien et charmant pour Fribourg) et qu’elle fut un véritable fleuron, centre d’activités intellectuelles et littéraires durant la Seconde Guerre Mondiale. Ceci grâce à l’éditeur Walter Egloff qui publia – excusez du peu – quelques grosses pointures de l’écriture dont Mauriac, Claudel, Aragon, Maritain…et même un certain Charles de Gaulle qui confiera trois manuscrits à la Libraire Universelle de France (LUF), sise à Paris mais issue de Fribourg !
Bref, la ville fut un creuset dont beaucoup ignorent l’importance qu’elle avait à cette époque. Et notre cicérone à moustaches, pipe au bec, de rappeler aux touristes lambda que la Saint-Nicolas est également une fête qui rassemble chaque année, les Fribourgeois par dizaines de milliers, comme quoi l’histoire et les traditions séculaires sont intimement mêlées sur les bords de la Sarine, aux reliefs escarpés de molasse, prenant vie en cascades médiévales.
A l’arrivée, ce livre pose un regard érudit et tendre sur un grand artiste contemporain qui, plutôt que de se dire artiste, se voulait œuvrant. Il retrace fidèlement le parcours d’Armand Niquille dont le destin se confond avec cette pittoresque ville qu’est Fribourg.
Quelque part, outre l’hommage rendu au peintre, c’est aussi cette ville suisse qu’il aime par-dessous tout que célèbre Claude Luezior, l’écrivain inspiré de ces terres pentues, dont Niquille dit que l’esprit étriqué de ce pays si complexe, c’est ce qui le sauve. Il en est parfois de même de la stature des artistes…
Laurent BAYART
in : Revue alsacienne de littérature (RAL),
Strasbourg, 2016
*
Claude LUEZIOR - TRILOGIE - éditions de L’HARMATTAN, Paris, 2015
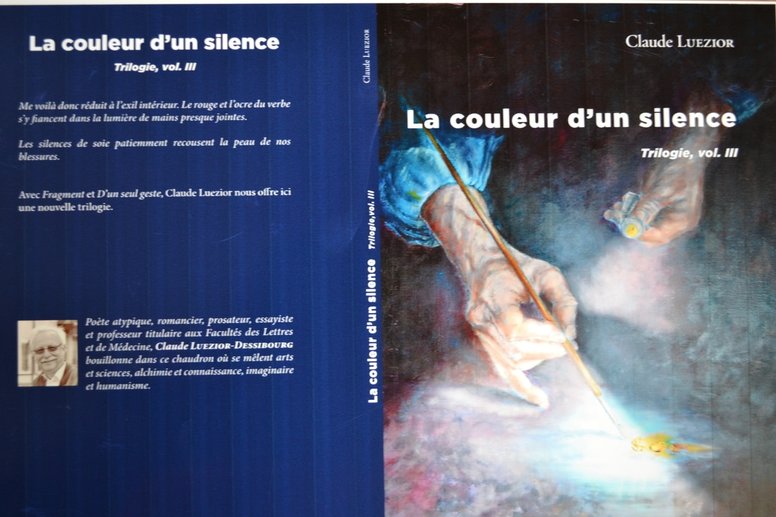
L’idée d’une trilogie en poésie peut surprendre. Dans le domaine de l’opéra, Wagner y est même allé d’une tétralogie ; Marcel Pagnol à fait la sienne : une autobiographie qui a connu un immense succès. Eh ! bien, moi, cela ne me surprend pas puisque je m’y suis essayé. Cela suppose un lien entre les recueils, une suite, un peu à la façon d’une saga. C’est ce que je vais essayer de découvrir. Je pense qu’il doit y avoir un projet initial. Nous verrons bien.
Volume 1 - FRAGMENTS :
Dans son propos liminaire, qui est à lui seul un morceau d’anthologie, que nous dit Claude Luezior ? « Dans sa forge le poète martèle ses mots... Se bat-il avec la technologie d’un autre âge ? Alors que la mode est au plastique, au slogan et au prêt à penser. » Un peu plus loin, il nous dit encore que « ces poèmes naissent dans un incubateur d’étoiles. » En quelques mots, il a tout dit : que la poésie est une lutte pour sauvegarder un patrimoine qui est mis à mal par la modernité et le snobisme qu’elle engendre, et que d’autre part, elle naît dans ce qu’il y a de plus profond en nous, de plus cosmique, ce qui nous fait dire que l’intelligence dépasse infiniment la matière qui l’a conçue. Trente de ces poèmes nous attendent, dans une métrique courte qui n’a pas besoin de rimes. Cette quête, nous la trouvons exprimée dès le premier texte : Originel. « nudité initiatique / dépouillement / de la mémoire / où se frôlent / tour à tour / errances frugales / et franges du sacré. » Qu’est-ce que le sacré pour nous sinon cet inénarrable, cet indescriptible, cet irréductible je-ne-sais-quoi qui fait de nous des chercheurs de l’ombre. Cette ombre qui nous accompagne sur le chemin que nous traçons, qu’elle nous précède au matin de la vie ou qu’elle nous prolonge le soir.
La poésie sert d’abord au poète ; elle sert à « hacher le charivari / de l’inconscience / pour que s’atténue un mal-vivre / lorsque s’effilochent / ses impasses / en déraison. » ( in DIRE) Elle sert aussi au lecteur, qui n’est pas insensé ( je pense à Victor Hugo ) au point de croire qu’il n’est pas aussi l’autre.
Recherche aussi de la beauté pure. Elle fait partie du sacré. Comment ne pas songer alors à la femme . Dans son poème intitulé NAUFRAGE, Claude Luezior conduit, sur une dizaine de strophes, une superbe métaphore entre la mer et l’amour, dans un érotisme d’excellence : « blottie / au creux / de l’assaut / déliée / face au récif / sauvage / qui l’empale / elle entrouvre / ses nacres / de coquillages... tellement / femme / elle donnera / chair / éternelle / au combat / du désir ».
Claude Luezior a aussi sa façon de protester, de s’insurger contre tout ce que la société a de malade. Il le fait en termes voilés mais percutants : dans brûlures : « les sbires de Vulcain / en toute incompétence / distribuent flammes / et torchères / à la cour du Prince // manants et sans-culottes / aux confins des terres / ne récoltent que cendres / sur leurs parchemins / assoiffés de lumière », dans PSYCHOSE : « folie du conquérant / qui massacre / son peuple / meurtres et rites /du pouvoir / en démesure / violence », ou encore dans prédateur : « en meute / les hyènes / accablent / un squelette // tant d’hommes / qui résument / les plus cruels / des prédateurs ».
Le poète est celui qui sait mesurer la vie pour y puiser la nécessaire sagesse qui doit guider notre parcours. Cela apparaît nettement dans ESPOIR : « mes orgueils suffiront-ils / à dépasser / les collines / où peut-être / luit / un rayon / de pastel ? » On retrouve cette tendance ( au sens de tendre vers ) dans camaïeu : « malgré tout / une voie lactée / où tètent là-bas /quelques lunes / oasis de clarté / où s’abreuvent / des rêves / archaïques.» On la sent bien cette recherche de soi mais aussi de l’univers.
Laissons-nous emporter par ce premier recueil dans les méandres de la conscience en espérant beaucoup encore de la suite.
Volume II - D’UN SEUL GESTE :
La supériorité du papier sur Internet, c’est le toucher. Cela est souvent souligné. Quand je prends en mains un recueil, je suis sensible à tout : me parle ici la superbe photo de couverture, réalisée par l’auteur : une femme floue qui ôte ou remet ( ambiguïté de l’instantané ) son voile de tulle. Celui d’une mariée ? Me parle l’exergue de Federico Garcia Lorca ; j’en retiens ces quelques mots : la brûlure qui tient les choses éveillées. Notre conscience en a besoin. Pour être à l’affût, ne pas accepter l’inacceptable. Mais aussi pour vivre de chaque instant, de chaque geste.
Il n’y a pas que ce geste de couverture, pris sur le vif, le geste est constamment présent tout au long du recueil : « D’un seul geste, provoquons le mystère où se nidifie l’énigme des nébuleuses lorsque les galaxies écopent les étoiles », lisons-nous encore en quatrième de couverture, cette phrase reprenant sous une autre forme le poème numéroté XXII ( Le poète a remplacé les titres par des nombres en chiffres romains - Les titres en effet ne sont pas indispensables, parfois trompeurs, parfois trop révélateurs de la suite ).
Mais qu’est-ce que le geste ? Un instant qui passe, marqué par une action qui se décide, qui balaie l’air, l’espace, qui s’efface aussitôt que fait, ne laissant trace que dans la mémoire. Le geste s’envole, à l’instar de la parole : « rue de l’éphémère cohabitent... tranches de vie / musiciens et guérisseurs / graffitis sonores / et sauvageonnes / d’un paradis perdu ... gamins en débandade / gestes furtifs / qui ne disent leur nom / baisers à la sauvette / pour amoureux aveugles... le temps d’un effleurement ».( XLI ) Et les gestes seulement ébauchés, qui ne voient pas vraiment le jour ? « demi-cercle / pour trancher / l’éphémère / le geste s’élève / sans jamais s’achever ». ( VII ) Au contraire, le geste peut se prolonger, se reproduire et perdurer ; en fait être suivi de toute une série de gestes. Ainsi dans le numéro XXIII : c’est l’ « étreinte démesurée / quand respire un instant / la tendresse dans l’ombre / et le fécond satin / que nul n’ose nourrir ». Dans le numéro XLV, le geste est magnifié, sacralisé : « le geste en majuscules / érige ses contours / ensorcelle ». il devient tout naturellement érotique : « défiant la virilité / du mâle / qui tournoie / les soies / sculptent le désir ».
Et le geste d’écrire ? Il a son importance, elle est peut-être même capitale. Tout commence à la préhistoire avec l’art pariétal ; et du sacré encore : « grotte capitulaire / de Lascaux / où le génie / de prêtres / en peaux de bêtes / prenait ses quartiers... grognements / de la caverne / que prolonge / aujourd’hui / un geste / sacré ». ( XXXVII ). L’instant d’un geste, gravé pour longtemps dans la pierre. On recherche déjà le temps perdu. Et le geste poétique ! « à la faille d’un rien / naît le poème / pistil d’un amant / que tout encore / étonne // organe où battent / des voyelles comme fibres / contractiles ». écrire, écrire... ! «J’y burine / mes territoires... sous la pointe d’acier / se coagulent / mes insomnies » ( XXXIV ).
Mais il est temps que je laisse au lecteur le soin de découvrir l’ensemble, de marauder, comme dit le poète dans l’univers de ses errances.
Volume III - LA COULEUR D’UN SILENCE :
D’un silence et non pas du silence. Celui dans lequel s’enferme le poète. Référons-nous encore au propos liminaire : « Me voilà donc réduit à l’exil intérieur où le silence va sécréter les plus intimes couleurs de ses pensées.» Ne nous y trompons pas. Ses pensées : celle du silence. L’auteur n’a pas écrit mes pensées.
Qu’est-il de plus parlant, parfois, que le silence ? Et n’a-t-on pas besoin de s’isoler pour penser ? Ce troisième recueil, je veux l’aborder selon ma fantaisie au risque d’interprétations qui ne seront pas dans les intentions de l’auteur. Mais celui qui écrit est souvent heureux des prolongements qu’il a pu susciter. Auxquels il n’avait pas forcément pensé. C’est une preuve irréfutable de richesse. Sans être abscons, très loin d’être hermétique, Claude Luezior demande à être lu en profondeur.
Le silence a-t-il une couleur ? Bien évidemment selon sa nature, ce qui le provoque, ce qui le nécessite. Pour moi, il a la couleur du vide, le vide intersidéral qui n’est que silence On peut dire que le silence occupe la presque totalité de l’univers. Silence rime avec solitude, volontaire ou pas. La lecture des textes m’en convainc, l’un après l’autre : « pourquoi ce cloître / dans l’enfermement / de prières / sans Dieu ? // Pourquoi ces silences / écorchés / pourquoi Chronos / devenu rapace ? » ( III ) Il n’y a pas besoin de croire pour prier. Prier dans l’Absolu, sous le poids de sa condition d’homme, pour le mal-être qu’elle peut engendrer. Rien n’empêche d’espérer autre chose, tout en n’y croyant pas. L’auteur parle de silences écorchés. N’est-ce pas plutôt le poète qui se sent écorché vif ? Qui ne souffre de soi, en soi, à de certains moments ? Ce silence, au fond, le poète ne voudrait-il pas le rompre ? Avec l’être aimé, avant de partir ? « avant l’inégale / lutte avec l’ange / avant l’ocre et le noir / où j’agonise déjà // je voudrais chuchoter / puériles paroles / un deux, peut-être trois / poèmes pour toi ».
( VI )
On sent que le poète a mûri, tout simplement vieilli. Et vieux moi-même, je suis en parfaite communion avec l’auteur. Mais pourquoi des lecteurs plus jeunes ne ressentiraient-ils pas la même chose ? « au déclin de ma vie / s’emboîtent les désirs // les désirs et leurs proies / comme feu et eau / qui fusionnent en fatales étreintes // au soir des rencontres / s’exhibe le rituel / // ce rituel de déesse / qui déplie les charmes / d’un instant où respire / la prière d’un espoir ». Le mot espoir évoqué plus haut est ici prononcé.
A cette solitude, à ce silence qui pèse lourd, je vois deux remèdes : la beauté incarnée par la femme, et sacralisée par les mots : « te réinventer / à mes gestes éphémères / là où les lèvres /de la nuit balbutient / là où l’aube exige /son tout premier désir... te rêver / à la faille de l’impossible / inconsciente et vive / juste aux rosées du sacrifice / et lever enfin le voile / sur tes yeux qui disent oui. » ( XXIV ) Par les mots ? et justement par l’écriture, voilà la seconde façon de guérir : « je t’écris ces grands silences / qui battent leur coulpe / drapeaux en déshérence / entre les phrases de nos vies... à nos aubes en berne / les silences de soie / patiemment recousent / la peau de nos blessures ». ( XLII )
Ce silence a finalement un côté bénéfique : il soigne il recoud, ne fût-ce qu’en pointillés, le tissu de nos vies que nos solitudes, nos effarements, nos errements avaient déchiré. Au fil du temps, il change de couleur.
Louis DELORME
Commandeur des Palmes académiques
*
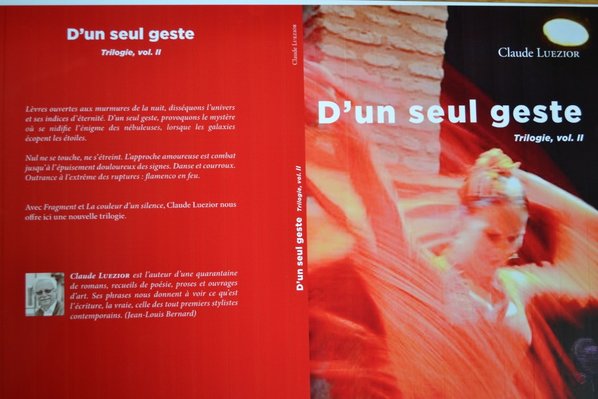
24 SEPTEMBRE 2015
Trilogie - Claude LUEZIOR par Michel Bénard
Editions l’Harmattan- collection Poésie (s) 2015.
Volume no I: Fragment. (87 pages)
Volume no II: D’un seul geste. (89 pages)
Volume no III: La couleur d’un silence. (97 pages)
Au fil des décennies, c’est au rythme de l’orfèvre que Claude Luezior cisèle son œuvre, romans, essais, ouvrages d’art et poésie, avec un égal bonheur, jusqu’à parfois tutoyer ou égratigner le ciel. Remarquable et incontestable parcours littéraire et poétique que celui de Claude Luezior.
Il pérégrine au balancement régulier du métronome, rien qui ne puisse arrêter l’élaboration passionnée et éclectique de son œuvre. Sa dernière « Trilogie » - I -Fragment – II - D’un seul geste - et – III - La couleur du silence - appartient à cette mouvance.
Patiemment, pareil à un bon compagnon artisan, il ajuste, peaufine ses mots sur un établi encombré de lettres, signes, songes, et il annonce la couleur dans cette nouvelle« Trilogie : »
Il fragmente !
« Ces poèmes sans rime, naissent dans un incubateur d’étoiles. »
Claude Luezior, ressent une nécessité de retour à l’originel, à la pureté initiatique, à l’heure des moissons et de l’engagement.
Au travers de ce besoin de dépouillement le verbe devient rédempteur.
Ce dernier nous forge toujours de brèves, mais remarquables formules.
« …/…le charbonnier
a cloué ses absences
aux portes de la foi. »
Une foi des plus discrètes vibre au fond de lui-même. Foi ? Ou plus précisément le questionnement d’un retour au sacré, à la symbolique initiale. Page après page nous cheminons dans la sacralisation et son parfait contraire se manifestant par une espèce de provocation.
Les vers qui se dévident entre les pages de cette « Trilogie » sont brefs, très courts, incisifs, ils vont à l’essentiel, semblables parfois à la manière des haïkus.
Il jongle avec de magnifiques autant que surprenantes métaphores, chaque strophe est en elle-même un poème. De fulgurantes images y fourmillent.
« …/…ouvre
les entrailles
du miracle
par ton geste
sacré…/…
La vie parfois s’embrouille, les chemins s’emmêlent sur le grand labyrinthe, mais pourtant la poésie est toujours présente pour réconforter nos incertitudes.
Les textes de cette fulgurante « Trilogie » se veulent libres, sans rime, sans ponctuation, la poésie ici n’existe qu’au prix de cette liberté effrénée autant qu’échevelée. Nous y ressentons la volonté de sobriété, le frissonnement mystique, l’épurement à la manière cistercienne en forme de chant grégorien.
Sans oser prétendre faire un comparatif élémentaire, je retrouve au fil des pages une résonance qui n’est pas sans rappeler un peu : « La montée du Carmel » de Saint Jean de la Croix.
« …/…au bout
d’une alchimie
de songes
et d’ave
toucher
le stigmate
et renaître
par la Croix…/…
Claude Luezior perçoit souvent dans l’existence, une grande hallucination, une déferlante d’angoisse, d’étranges mouvances paranoïaques, les démences qui spolient et mettent l’homme à nu. Qui le place face à lui-même et à son insignifiance.
Nous sommes ici confrontés à une remarquable poésie épurée confondue à une profonde réflexion existentielle. Parfois il nous est même possible de nous égarer en quelques espaces ésotériques, en d’énigmatiques cryptes mythiques.
L’ouvrage est fragmenté de subtils aphorismes et sentences qui nous resituent face à nous même en nous abîmant dans une sorte de contemplation.
Il arrive aussi à Claude Luezior de se faire quelquefois iconoclaste ! Il fait l’autodafé des clichés, des idées reçues, des pensées formatées. Il « mécréante » gentiment, il
« anticléricalise » avec lucidité, toutes les religions prennent une estocade au passage.
La purification touche même la ponctuation qui est réduite à sa plus simple expression.
Par l’effet d’un seul geste, Claude Luezior nous invite à changer de regard. Il est un mystique animiste, un prince de la liberté. Ce geste alphabétisé est tout l’acte révélateur de la poésie. Nous y croisons quelques fois des échos nietzschéens à l’esprit chamanique.
…/… intemporelles
partitions
pour druides
qui parachèvent
les fantasmes
d’un cosmos
intime.//…
Il nous arrive également de décrypter des scènes rappelant Jean-François Millet, des tintements d’angélus sur les terres pacifiées du soir. Effleurement de temps à autre sur la pointe des pieds de l’hermétisme, où notre poète avertit par des voies détournées que l’amour peut conduire jusqu’à l’implacable loi de l’anéantissement tel le mythe de Prométhée.
La vie est une sorte de turbulence, de folie brodée de désespérances, de stigmatisations festonnées d’aveugles insouciances, d’infantiles démesures noyées par des rires crédules. La chute et son déclin sont inévitables, alors autant sombrer dans le fol oubli du grand carnaval final, protégés que nous serons par le masque de l’anonymat.
Un temps pour tout, vie, amour, frénésie, larmes, beuveries des oublis.
Le poète fait en sorte de s’égarer, de se perdre un peu sur l’océan de l’existence, alors il quitte son port sans boussole, sans sextant, ni astrolabe, mais il sait encore lire dans les étoiles.
Claude Luezior le confesse, il a joué au poète plutôt que de porter le glaive, il a préféré et grand bien lui en a pris, agiter un calame effarouché.
A choisir je préfère l’image de Claude Luezior en poète ébloui, plutôt qu’en mercenaire !
En touche finale il ne reste plus qu’à faire l’amer constat des heures vulgaires, de la perte d’un certain sens du beau.
« …/… à quoi bon ces lignes en perdition
que l’on nomme esthétisantes
alors que des gens, dits de lettres
ont perdu jusqu’au sens du beau ?.../…
Claude Luezior se situe plus que jamais dans le questionnement de la grande confusion de ce début de siècle, il s’indigne du grand mensonge libéral mondialisé au détriment des peuples et à l’aliénation des nations.
Sous la bannière du doute le poète se réfugie dans les alphabets de l’amour et tourne son regard vers une éternité nouvelle colorée de silence.
Une belle et longue route à cette « Trilogie » qui laisse flotter autour de nous, l’instant d’un rêve l’étonnement d’un voyage intemporel.
Michel Bénard.
Lauréat de l’Académie française.
In : http://www.couleurs-poesies-jdornac.com/2015/09/trilogie-claude-luezior-par-michel-benard.html
25 9 2015
*
Clames (SLAMS) de Claude Luezior, Ed. tituli, Paris, nov. 2017
Des spécialistes, ingénieurs du son des profondeurs, avaient bien lancé l'alerte : « les sismographes sont en vibration, des fumeroles s'échappent en un point précis de cette région apparemment calme située à Fribourg en Suisse. » Il y avait eu déjà sur les ondes ce fameux ''Je heurte parce que je suis heurtoir''. Beaucoup s'en étaient émus mais peu avaient prévu ce qui allait suivre. Et voilà, l'implosion-explosion, en direct, dans toute son ampleur : CLAMES que je lirais C.L. ÀMES ; les mille âmes de Claude Luezior. Il ne s'agit pas de slams ; même si cette forme orale a pu çà et là laisser quelques belles émotions, beaucoup ne sont que faciles coups de gueule - défouloirs.
Il s'agit là d'un réel épisode volcanique littéraire. Les paroles issues du tréfonds du magma poétique éclatent en plein ciel et se répandent, brûlantes, sidérantes. Et quels échos ! On en est ébranlé, fasciné, médusé : Coupe / les flaques / de mes chairs /insomniaques / Coupe-feu / de mes incendies / traque / mes braises volcaniques / (...) coupe-faim de mes lexiques / où se détraquent / les alambics (...) où craquent. / mes suppliques. Coupe : en moi le diabolique / coupe mon Armagnac / d'hérétique (...)
( Coupe : page 9)
Plusieurs épisodes telluriques se suivent, alternés d'accalmies ( d'aclamies?) où se déposent les cendres fertilisantes, puis viennent les silences. Tout se passe comme si le poète Claude Luezior avait été longtemps bâillonné et qu'il ait enfin arraché ce bâillon de politesse bienséante face à l'urgence ; urgence non pas de penser mais de DIRE ; PENSER pour DIRE et DIRE pour PANSER.
Car l'accalmie provisoire venue, c'est là que l'on découvre le nouvel horizon ; le nouvel état des lieux qui ne seront jamais plus les mêmes. L'espace est à réinventer, la terre intérieure, à reconstruire ; il est temps, comme pour Saint-Exupéry, de s'en remettre à la science poétique des étoiles : une voie lactée par-ci / un astéroïde par- là / tôt dans la nuit / l'astro-mécanicien / broie / ses trous noirs / mains nues / dans des cratères de lune ( astrologue : page 33)
CLAMES, comme ce mot l'indique, c'est toute la richesse du magma intérieur de Claude Luezior qui, par des failles stromboliennes, jaillit devant nos yeux, répandant à nos pieds scories de désirs, cendres de douleurs et pépites d'espoir. Buvons à la coupe de libation finale que nous offre le poète Claude Luezior, de sa chaude et belle voix rocailleuse : buvez / à l'aune de vos élans / à la mesure / de votre désir / à gorge déployée / buvez jusqu'à plus soif / et surtout / buvez-moi ! ( soif : page 71 ).
Invitation à la table de l'Olympe helvétique ?
Jeanne Champel Grenier
Cliquer ici pour modifier.
Claude LUEZIOR : « CLAMES - poèmes à dire - », éditions TITULI, Paris
Avis aux amateurs ! Dans son dernier recueil poétique « CLAMES – poèmes à dire », l’écrivain suisse Claude LUEZIOR se place d’emblée dans un cousinage littéraire avec le « slam », en jouant de la quasi-homonymie du titre de l’ouvrage. Un cousinage nuancé, toutefois, car si Claude revendique l’oralité de ses textes, dans la tradition séculaire des bardes, chamans et autres diseurs, il avoue quelques réserves à l’égard du slam ou plutôt des dérives de ce genre contemporain et novateur, pour lequel certains, comme pour le rap, ont cédé un peu trop vite, tant sur la forme que sur le fond, aux facilités de la spontanéité, et aussi aux sirènes de la diction libre.
Quoi qu’il en soit, ces vingt-huit textes du recueil, au-delà de la simple lecture, se veulent autant de « coups de poing » à asséner verbalement, par une diction adéquate, facilitée par le phrasé de leur auteur. Les rythmes rapides et saccadés y sont en effet nourris par des vers courts, très courts, parfois réduits à un seul mot, et l’auteur joue avec brio de l’allitération, de l’assonance, de l’anaphore, de la rime riche - parfois inattendue, et de tous les jeux de sonorités possibles.
L’adéquation de la forme et du fond est omniprésente, comme pour mieux faire ressortir le mordant, la tonalité satirique et la volonté persuasive des idées exprimées. Beaucoup de ces textes (EPURATION, SANS-PAPIER, INDECENCE, LIBERTE, DJIHAD etc…) expriment en effet une vision parfois hallucinée des défauts, tares, fautes, nuisances et imperfections de la société actuelle. Citons : « An un : voici ma nouvelle ville (…) des menottes pour chacun », « Assez de ces brutes(…) assez des canonnades », « Voilà qu’ils m’écrouent, me désavouent, me bafouent (…) moi le sans-culotte »…
Heureusement, dans d’autres textes (CONTREPOINT, ANTIDOTE, ULTIME etc…), l’auteur tempère l’ensemble par une vision plus optimiste de la vie et quelque confiance en l’avenir: « Antidote au crépuscule, un rossignol qui appelle », «Le printemps débarque sans détours, avec sa marmaille d’oiseaux, sa fleur au fusil et son air de Gavroche immature », « N’en déplaise à ton ingratitude longuement j’aimerai, j’aimerai tes vermeils »…
Ajoutons que les Editions Tituli, qui publient l’ouvrage, gèrent une librairie-galerie au 142, rue de Rennes, 75 006 PARIS.
PHILIPPE VEYRUNES
Lauréat de l'Académie française
NB : Extraits disponibles sur le site de l'éditeur tituli : http://www.tituli.fr/catalog/product/view/id/104/s/clames/category/3/
(faire glisser la souris de droite à gauche)
Clames (poèmes à dire) de C. Luezior, éd. tituli, Paris
Ce nouveau livre de Claude Luezior est une manière de retour aux sources de la littérature et de la poésie car l’écrivain fribourgeois nous rappelle dans son Avant-dire (et non pas Avant-lire !) que la poésie est avant tout orale. Oralité au bord du feu, héritage des bardes et chamans. Ainsi, a-t-il intitulé fort judicieusement Clames ce livre qui se lit à voix haute et dont les mots sont destinés à être mis en espace, petits lutins syntaxiques s’affranchissant du douillet couffin blanc de leurs feuillets.
C’est aussi une manière originale d’aller à la rencontre d’un auteur atypique dont l’imaginaire poétique magistral nous invite à une farandole d’images et de paysages somptueux. Ici, les mots virevoltent et savourent cette liberté aérienne, faite de sonorités et de vibrations de partage. …les clamer, dans leur nudité naturelle, leurs assonances, leur boléro. On se délecte à les entendre croustiller, pâte craquante dans notre bouche pour leur offrir le précieux réceptacle de conques d’oreilles en quête de luminosité acoustique et d’une écoute habitée.
Comme pour ses précédents ouvrages, l’orpailleur du verbe nous entraîne dans une gourmandise syntaxique en jouant sur les touches du clavier. Il en ressort une musicalité harmonieuse et ludique car l’écriture est aussi un jeu… d’orfèvre : Quand le oui/ n’est plus non/ et que le oui a un nom… Baladin et saltimbanque de l’oralité retrouvée, le poète titille sa muse qui s’amuse et s’acoquine de son coquin de troubadour maniant l’humour, tel un jeu tout en finesse et sensualité : N’en déplaise/ à tes aréoles/qui m’affolent… Ritournelle chaleureuse de vers qui pourraient très bien prendre la forme de chansons ?
Écriture parfois à la Maurice Carême avec une poésie qui peut se dire dans tous les sens. Je vous l’avais confié, Luezior slame et surtout clame bien haut : la poésie est de retour et ne mâche… pas ses mots ! Derrière sa moustache épicurienne et sa pipe de sage bienheureux, Luezior fulmine devant les tabloïdes de la barbarie qui parsèment son jardin de ronces et de chardons en chevaux de frise : Et poignardent/ et décapitent/ l’autre/ le frère/ même/ le leur/ le vôtre.
Les mots dits ont souvent la force du brûlot lorsqu’ils n’hésitent pas à sortir du nid calfeutré de leurs pages blanches pour étreindre nos âmes et parler à nos cœurs. Clamer son innocence coupable de mots si élégamment dits… Le poète avoue mais ne se dédit pas. Voilà qui est bien dit !
Laurent BAYART
écrivain, critique, Strasbourg
Ce nouveau livre de Claude Luezior est une manière de retour aux sources de la littérature et de la poésie car l’écrivain fribourgeois nous rappelle dans son Avant-dire (et non pas Avant-lire !) que la poésie est avant tout orale. Oralité au bord du feu, héritage des bardes et chamans. Ainsi, a-t-il intitulé fort judicieusement Clames ce livre qui se lit à voix haute et dont les mots sont destinés à être mis en espace, petits lutins syntaxiques s’affranchissant du douillet couffin blanc de leurs feuillets.
C’est aussi une manière originale d’aller à la rencontre d’un auteur atypique dont l’imaginaire poétique magistral nous invite à une farandole d’images et de paysages somptueux. Ici, les mots virevoltent et savourent cette liberté aérienne, faite de sonorités et de vibrations de partage. …les clamer, dans leur nudité naturelle, leurs assonances, leur boléro. On se délecte à les entendre croustiller, pâte craquante dans notre bouche pour leur offrir le précieux réceptacle de conques d’oreilles en quête de luminosité acoustique et d’une écoute habitée.
Comme pour ses précédents ouvrages, l’orpailleur du verbe nous entraîne dans une gourmandise syntaxique en jouant sur les touches du clavier. Il en ressort une musicalité harmonieuse et ludique car l’écriture est aussi un jeu… d’orfèvre : Quand le oui/ n’est plus non/ et que le oui a un nom… Baladin et saltimbanque de l’oralité retrouvée, le poète titille sa muse qui s’amuse et s’acoquine de son coquin de troubadour maniant l’humour, tel un jeu tout en finesse et sensualité : N’en déplaise/ à tes aréoles/qui m’affolent… Ritournelle chaleureuse de vers qui pourraient très bien prendre la forme de chansons ?
Écriture parfois à la Maurice Carême avec une poésie qui peut se dire dans tous les sens. Je vous l’avais confié, Luezior slame et surtout clame bien haut : la poésie est de retour et ne mâche… pas ses mots ! Derrière sa moustache épicurienne et sa pipe de sage bienheureux, Luezior fulmine devant les tabloïdes de la barbarie qui parsèment son jardin de ronces et de chardons en chevaux de frise : Et poignardent/ et décapitent/ l’autre/ le frère/ même/ le leur/ le vôtre.
Les mots dits ont souvent la force du brûlot lorsqu’ils n’hésitent pas à sortir du nid calfeutré de leurs pages blanches pour étreindre nos âmes et parler à nos cœurs. Clamer son innocence coupable de mots si élégamment dits… Le poète avoue mais ne se dédit pas. Voilà qui est bien dit !
Laurent BAYART
écrivain, critique, Strasbourg
FRAGILE
(Claude Luezior, éditions La Bartavelle)
Un chant à l’amour, ses vicissitudes, ses doutes, puis son triomphe final.
Après un chemin d’éloignement, de solitude – et peut-être de rupture –, l’amour retrouvé en la chair et l’esprit « Je crois aux retrouvailles/après l’errance de l’écho/et les râles blessés/des renards en solitude. » « Toucher le calice/pour que nos bouches/à l’orée des fusions/aient ensemble/le goût du sacré. »
Une ode à l’amour charnel et à la femme aimée, avec de très belles évocations aux accents baudelairiens : « Je bois ton regard/ magnétique/Je bois tes yeux/ d’ébène/… » ; « De tes dunes/ instinctives/s’évaporent/ des opalescences/ d’aube. » « Charnus oratoires/où l’ordonnance/ des prières/est survivance/d’une déesse/ profane. »
Mais l’amour n’est pas seul, il y a la poésie, et « vivre en poètes » est suspect en ce monde, aussi le poème interroge : combien sommes-nous à partager cet état ? Cent-mille, mille, ou se résume-t-il « à deux » ?
En l’amour retrouvé, le pacte d’alliance se veut renouvellement, dépassement des errements anciens, de la vie morne et sans surprise de la vie ordinaire, et apaisement des blessures infligées par les petitesses : « Ensemble nous voudrons/effacer lentement/la forge des volcans/qui dévorent leurs fidèles/l’immuable quadrillage des routes déjà tracées/et l’infinie morsure des gens en petitude. »
L’image du berger et de la bergerie est récurrente, lampe christique recourbée en l’immanence maritale : « Etre le berger un jour/d’une femme/et de ses enfants. »
Outre les extraits mentionnés précédemment, j’ai particulièrement apprécié – parmi d’autres – ces belles formulations : « Elle efface d’un geste fruité/les rides à mon front/où pulse le désir. », « Que l’on soit poète/troubadour de l’ocre/ou chercheur de lumière/… », « Là unique/et nécessaire/à la frange/de mes argiles/… », et ce magnifique : « Au fond des bergeries/frissonne/le poumon bleu/du silence . »
Superbes – et non dépourvus d’une pointe d’humour et d’autodérision – les titres des chapitres, notamment : « Peut-être n’était-il que le berger de fragiles armatures », « Les herbes longues boursouflaient le crépuscule de chuchotements », « Au bout du chemin était la pierre sacrée ».
Une langue sobre, épurée et à hauteur d’entendement, qui ne recherche ni l’effet ni l’artifice. Des images maîtrisées qui jamais ne brouillent les cartes ni ne noient le sens. Une poésie qui fait le choix de la sincérité et du partage avec la communauté des hommes.
François Folscheid
(Claude Luezior, éditions La Bartavelle)
Un chant à l’amour, ses vicissitudes, ses doutes, puis son triomphe final.
Après un chemin d’éloignement, de solitude – et peut-être de rupture –, l’amour retrouvé en la chair et l’esprit « Je crois aux retrouvailles/après l’errance de l’écho/et les râles blessés/des renards en solitude. » « Toucher le calice/pour que nos bouches/à l’orée des fusions/aient ensemble/le goût du sacré. »
Une ode à l’amour charnel et à la femme aimée, avec de très belles évocations aux accents baudelairiens : « Je bois ton regard/ magnétique/Je bois tes yeux/ d’ébène/… » ; « De tes dunes/ instinctives/s’évaporent/ des opalescences/ d’aube. » « Charnus oratoires/où l’ordonnance/ des prières/est survivance/d’une déesse/ profane. »
Mais l’amour n’est pas seul, il y a la poésie, et « vivre en poètes » est suspect en ce monde, aussi le poème interroge : combien sommes-nous à partager cet état ? Cent-mille, mille, ou se résume-t-il « à deux » ?
En l’amour retrouvé, le pacte d’alliance se veut renouvellement, dépassement des errements anciens, de la vie morne et sans surprise de la vie ordinaire, et apaisement des blessures infligées par les petitesses : « Ensemble nous voudrons/effacer lentement/la forge des volcans/qui dévorent leurs fidèles/l’immuable quadrillage des routes déjà tracées/et l’infinie morsure des gens en petitude. »
L’image du berger et de la bergerie est récurrente, lampe christique recourbée en l’immanence maritale : « Etre le berger un jour/d’une femme/et de ses enfants. »
Outre les extraits mentionnés précédemment, j’ai particulièrement apprécié – parmi d’autres – ces belles formulations : « Elle efface d’un geste fruité/les rides à mon front/où pulse le désir. », « Que l’on soit poète/troubadour de l’ocre/ou chercheur de lumière/… », « Là unique/et nécessaire/à la frange/de mes argiles/… », et ce magnifique : « Au fond des bergeries/frissonne/le poumon bleu/du silence . »
Superbes – et non dépourvus d’une pointe d’humour et d’autodérision – les titres des chapitres, notamment : « Peut-être n’était-il que le berger de fragiles armatures », « Les herbes longues boursouflaient le crépuscule de chuchotements », « Au bout du chemin était la pierre sacrée ».
Une langue sobre, épurée et à hauteur d’entendement, qui ne recherche ni l’effet ni l’artifice. Des images maîtrisées qui jamais ne brouillent les cartes ni ne noient le sens. Une poésie qui fait le choix de la sincérité et du partage avec la communauté des hommes.
François Folscheid
|
Eine Hommage an die Kathedrale
CAROLE SCHNEUWLY Die Rute fest in der Hand: Beim St.-Nikolaus-Fest von 1952 war der Schmutzli besonders böse. Der Freiburger Autor Claude Luezior hat poetische, kurze Texte rund um die Kathedrale St. Nikolaus geschrieben. Ergänzt mit Fotografien von Jacques Thévoz, sind diese nun als Buch erschienen.«Die Kathedrale St. Nikolaus ist das zentrale Symbol der Stadt Freiburg und hat mich schon immer fasziniert.» Das sagt der Freiburger Schriftsteller Claude Luezior, welcher der Kathedrale nun eine Sammlung kurzer, poetischer Texte gewidmet hat. Diese sind soeben in Buchform erschienen, herausgegeben von der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg und ergänzt mit Fotografien von Jacques Thévoz aus der Bildersammlung der Bibliothek. «Unsere Publikationen betreffen normalerweise unsere eigenen Bestände», sagte Silvia Zehnder-Jörg von der Kantons- und Universitätsbibliothek gestern vor den Medien. Es sei darum eine ungewöhnliche Anfrage gewesen, als Claude Luezior mit seinem Manuskript an die Bibliothek herangetreten sei. «Doch in Verbindung mit den Fotografien aus unserer Sammlung ist ein harmonisches Gesamtwerk entstanden.» Die Bilder hat der Autor selber ausgewählt. Er habe sich für jene von Jacques Thévoz (1918–1983) entschieden, weil diese dem ironischen, schalkhaften Ton seiner Texte am besten entsprächen, so der 63-Jährige. In der Sammlung der Kantonsbibliothek befinden sich insgesamt rund 60 000 Fotografien von Thévoz. Claude Luezior heisst mit bürgerlichem Namen Claude-André Dessibourg und ist hauptberuflich Arzt. Unter dem Künstlernamen Claude Luezior hat er seit 1995 über 40 Bücher veröffentlicht und dafür mehrere Preise erhalten. Das Buch «Mystères de Cathédrale» ist für 25 Franken in der Kantons- und Universitätsbibliothek und im Buchhandel erhältlich (Texte auf Französisch). |
Cliquer ici pour modifier.
Article entre médecine (Dessibourg) et création littéraire (Luezior), paru dans la Revue médicale suisse, 2009 et disponible sur le Net : revmed.ch/revuemedicale-suisse/2009 :
RÉFLEXION
Médecine, sciences humaines et art : approche transculturelle
Claude Luezior-Dessibourg
Depuis des temps immémoriaux, l’homme a eu besoin de maîtriser maints problèmes complexes que lui posait la nature. L’histoire des sciences, de Pythagore à de Broglie, en passant par Newton, Pasteur ou Curie, montre que le monde peut être analysé en nombre de lois, équations et formules pour essayer de comprendre.
Déjà ces grands savants, en sus de leur créativité, mais également de leur esprit de modestie eurent l’intuition que leurs découvertes n’étaient que le fragment d’une globalité qui les dépassait. Contrairement aux pures mathématiques, on s’est rendu compte, en particulier dans l’étude du vivant, que l’ensemble dépassait largement la somme des parties, en d’autres termes que 1 + 1 > 2.
Si le médecin a, de longue date, la conviction que l’homme est davantage que ses organes, le biologiste et le généticien modernes sont confrontés à une incroyable richesse dont l’analyse repousse sans cesse plus loin un principe de vie qui leur échappe…
Sur sa propre sente, le psychologue Jung, par l’étude des mythes, constate une manière de «valeur ajoutée» aux individus. Le philosophe et théologien Teilhard de Chardin,1 décrit un processus de complexification progressive de la matière, puis de l’homme et de la société vers Dieu, cheminement bien supérieur à un ensemble de mutations.
Il en est de même du phénomène artistique qui est précisément ce «plus» ajouté aux compétences académiques du peintre ou du musicien. La poésie, qu’elle soit scandée ou qu’elle se niche dans la prose, réside à la synapse des mots et va bien au-delà de la signification primaire de ceux-ci.
Chercheurs et créateurs n’ont pu faire l’économie d’un écartèlement de leurs acquis, d’une vision pluridimensionnelle afin d’aller au-delà de leur pré carré. Ainsi, un mathématicien comme Einstein ou un peintre mystique tel Niquille2 outils dépassé leurs domaines respectifs en inscrivant leur pensée, grâce à leur imaginaire et à leur «œil intérieur», dans une conception globale de l’univers. Devant la tendance à la surspécialisation de nos sociétés, nous constatons un besoin accru de porosité, de flux entre les sciences «dures» et les sciences humaines. Au-delà des fécondations culturelles entre les civilisations, c’est bien une interaction entre la «tribu» des scientifiques et celle des artistes qui est ici notre propos. Que dire en particulier des relations entre le monde scientifique et celui de la poésie ? Ces deux planètes, qui ont l’air de s’ignorer superbement et dont les modes de fonctionnement semblent singuliers, sont-elles en réalité si éloignées l’une de l’autre ?
Concrètement, à l’heure de nos cloisonnements mutuels, le maître mot de ces symbioses, serait-il la transculturalité ?
Les sciences peuvent-elles contribuer à structurer, nourrir l’imaginaire du poète, enrichir sa langue, lui offrir des outils novateurs, d’autres moyens d’expression, lui fournir une scène, voire des médias pour diffuser sa parole?
En retour, la poésie donnerait-elle à nos sociétés technologiques ce supplément d’âme dont elle a besoin, une appréhension plus globale de l’humain, l’occasion d’une réflexion cosmique et éthique, une approche intuitive indispensable à la création scientifique?
Analyser pour comprendre
On ne peut pas concevoir la physique sans particules élémentaires, la biologie sans cellules, l’électronique sans digitalisation. La science ne saurait exister sans l’analyse des phénomènes en processus fondamentaux. Approche brillante mais insuffisante. En effet, le chercheur est, malgré d’indéniables victoires, confronté à la nature qui est bien plus intelligente que nous, comme le dit dans un sourire Gianotti, physicienne au CERN, alors que matière et antimatière continuent à défier ses collègues…
La génétique, qui remplit des milliers d’ouvrages et des millions de pages internet, semble-t-elle résoudre une énigme ? En fait, elle entrouvre un labyrinthe. Le génome humain a-t-il été décrypté grâce à une foultitude d’ordinateurs ? Nous voilà devant une encyclopédie presque illisible, dont seules quelques clés sont à notre disposition. On est bien loin du rêve «un gène – une maladie», «un ciseau génétique – une guérison», la plupart des affections, notamment psychiques, étant polygéniques, à savoir dépendantes d’un ensemble de gènes interagissant les uns avec les autres. Voilà donc les espoirs de certains, pour ne pas dire l’arrogance d’autres, battus en brèche. La dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les psychoses, ne sont guère explicables par la régulation aberrante d’une partie précise du cerveau. La tendance actuelle est à les considérer comme des dysfonctions de réseaux neuronaux dans le cadre d’une nouvelle cartographie, plutôt dynamique qu’anatomique.
C’est ici qu’intervient le principe de modestie : le vrai scientifique n’est pas celui qui dit «je sais», mais celui qui dit «je ne sais pas», selon notre ancien professeur de chimie inorganique von Zelewsky. Phrase difficile à comprendre pour les doux carabins avides de connaissances que nous étions, au matin d’une leçon inaugurale. Et pourtant, la sentence n’a paradoxalement cessé de prendre de l’ampleur au fur et à mesure des décades, au cours desquelles un pauvre savoir s’est accumulé dans nos têtes. Un problème central en didactique est de définir les zones grises entre le je n’ai pas compris et le on ne comprend pas. Ce qui rend le cognitif nettement plus intelligible. Ce qui donne aussi aux sciences «dures» une tonalité de sciences «humaines». Le scientifique, c’est celui dont l’intelligence (de inter legere : choisir parmi) n’est pas arrêtée par ce qu’il sait, mais celui qui demeure dans l’ouvert de ce qu’il cherche.3
Etrange équation : 1+1> 2 : constellation biomédicale
Les mécanismes cellulaires intimes et des modes d’action pharmaceutiques restent donc largement méconnus. En dépit d’immenses recherches, la véritable cause de la sclérose en plaques, de l’Alzheimer ou de l’épilepsie, pour ne citer que ces affections, reste pour le moins mystérieuse. Malgré l’étude de l’être humain en organes, systèmes, entités génétiques et réseaux, malgré l’intégration de paramètres chimiques, pharmacologiques, biotechnologiques mais également psychologiques et sociologiques, on peut avoir l’impression, dans nos tentatives d’appréhension du vivant, de multiplier constamment les énigmes alors que l’hypothèse X vient d’être résolue.
Notre intention n’est pas d’entrer ici dans la dialectique «hasard et nécessité (Jacques Monod) face à la foi en un Dieu créateur de l’univers». Nous en sommes bien incapables : qui l’est réellement, d’ailleurs ? Notre position (assez fluide, il faut l’avouer, car nous sommes là dans des sables mouvants…) est un peu celle d’un panthéiste curieux et actif, celle d’un «simple», dans le sens philosophique du terme, d’un «ravi» face au jour qui se lève. Comme si la science, en l’occurrence la médecine (qui, en fait, trempe ses racines à la fois dans les sciences dures et les sciences humaines et qui les applique, tant que faire se peut, au patient – de patere, celui qui souffre –) ne cessait, en butte à l’insondable complexité, de se frotter à un principe tiers. Qu’on le nomme Dieu, Allah, la Nature ou le Hasard.
Doux amalgame entre la rigueur scientifique et une dimension philosophico-poétique ou nécessité vitale d’une pensée plus large pour supporter le quotidien en détresse ?
Psychologue et théologien
L’être humain est également histoire personnelle et expériences de vie, il s’inscrit dans la société et la société s’inscrit en lui. Les multiples interactions entre les individus les enrichissent, les construisent. Cette nécessité viscérale de relation à l’autre, qui rejoint le il n’y a de «je» que pour un «toi» et de «toi» que pour un «je» de Leloup4 est une constante chez l’homme. Il est évident que le corps social d’un milliard d’individus est supérieur à la somme de ses membres. Interviennent, parmi de nombreux facteurs, les tenants et aboutissants économiques, géographiques, historiques, culturels, mais également de grands mythes sur lesquels Jung a beaucoup insisté. Il en est de même des archétypes, images anciennes qui appartiennent au trésor commun de l’humanité. Ces représentations seraient indépendantes de toute acquisition personnelle et constituent l’inconscient collectif. Ce phénomène additionnel jouerait un rôle capital dans le comportement des masses mais également dans la construction intrapsychique des uns et des autres.
L’homme est, par ailleurs, projection de lui-même vers un plus haut qui le dépasse ; n’est-il ainsi, quelque part, également prière ? Aussi loin que l’anthropologie puisse aller, on a découvert dans les tombes les plus primitives des squelettes placés dans un certain ordre, des traces de peinture sacrée, des reliques et des amulettes, probables «traits d’union» avec une force supérieure. L’appétence pour une divinité a été décrite tant par des anthropologues, des psychologues, des sociologues, des historiens, que par des religieux de toutes obédiences. Druides, chamans, mages et prêtres (et pourquoi pas les poètes, dans le sens archaïque du terme, à savoir ceux qui «cherchent commerce avec l’infini», ceux qui «prient» pour une extension cosmique du quotidien) ont, à la fois par la lyre ou la croix, par la louange ou la quête d’un Graal, accompagnés vivants et morts au seuil de l’étrange barque les menant par delà le soleil.
Cette élévation de la matière vers l’homme, de l’homme vers un corps social qui lui-même monte vers le Corpus Christi est d’ailleurs l’axe de pensée d’un Teilhard de Chardin :1 «Vie et conscience ne sont plus des anomalies accidentelles de la nature ; mais dans la Biologie apparaît soudain une face complémentaire de la Physique et de la Matière. Ici, je le répète, l’Etoffe du Monde qui se désagrège en rayonnant son énergie complémentaire, et là, cette même étoffe qui se rassemble en rayonnement de la Pensée. Du fantastique aux deux extrémités. Mais l’un n’est-il pas nécessaire pour équilibrer l’autre ?» Si tous n’adhèrent pas à la vision globale, pour ne pas dire poétique, de Teilhard, force est de constater, même dans une société laïcisée comme la nôtre, le besoin incoercible, dans toute l’histoire de l’humanité, d’un «plus», d’une force centrifuge vers un au-delà.
Peintre et poète
En sus des sentiers biomédical, psychologique et philosophique brièvement évoqués plus haut, un modèle illustrant le singulier axiome 1 + 1 > 2 est le domaine artistique, en particulier la poésie. Comme si cette discipline devenue marginale pour la plupart de nos contemporains recelait en elle un mode de fonctionnement exemplaire à partir du langage dit «véhiculaire» (qui porte le sens usuel des mots).
Dire que la peinture va au-delà du trait représentant l’objet figuré et bien au-delà du support employé ou de la couleur est un truisme. Elle est avant tout une vision déformée, amalgamée, reconstruite dans le cortex du peintre. Certains tableaux peuvent devenir buissons ardents qui, sous la qualité d’un vrai regard, s’enflamment.5 Il en est de même en poésie : émotion secrétée à la synapse du verbe, elle n’est plus langue ordinaire mais devient authentique création. Elle est par essence l’étincelle à la faille de plaques tectoniques, la plus-value du 1 + 1 qui est bien davantage que 2. Ce, contrairement aux personnes qui réduisent la poésie à une formule littéraire verticale et rimée. Sang de l’écriture, elle lui propose son style. Elle est, pour citer Couquiaud,6 ce «Tiers exclu» qui naît lors d’un changement de niveau au sein de la sensibilité et du rapport entre les mots. Ce phénomène est généré dans une parentalité auteur-lecteur. Ce dernier participe avec son propre vécu, son propre psychisme. D’où vibration, communion avec le poète : «j’aurais voulu dire cela». D’où stade ultime d’adéquation avec le cosmos, de plénitude, de prière. Selon l’expression de Berenson :7 Le moment esthétique devient un moment de vision mystique.
En résumé, si la démarche analytique est grande pourvoyeuse de connaissances, il paraît évident qu’une approche plus large est pour le moins indispensable afin d’appréhender la cosmographie humaine. Contrairement aux pures équations mathématiques.
Ainsi :
• l’être est supérieur à l’ensemble de ses organes (y compris son cerveau).
• L’humanité est davantage que la somme de milliards d’individus.
• L’évolution est plus que l’addition de mutations désordonnées.
• La peinture dépasse la reproduction d’une réalité et la poésie est magie secrétée à l’interface des mots.
Se dépasser grâce à l’imaginaire et à l’introspection
Pour cette alchimie «supramathématique», comment l’homme parvient-il à se dépasser ? Einstein a proposé cette phrase assez surprenante : «L’imaginaire est plus important que la connaissance.» Son propos étant qu’il fallait parfois, d’abord, un rêve, un concept, une vision, avant que les équations et les expérimentations puissent les prouver. Citons ici également le peintre mystique Niquille :5 «Toujours plus loin dans une sorte de théologie de l’œil. Où l’œil intérieur s’allie au regard extérieur pour atteindre l’intelligence de l’âme.» Lui qui disait : «Je ne suis qu’un artisan au pied de la croix.» ou encore : «Si je prends la plume, c’est avec la volonté presque désespérée, au-dessus de mes forces et de mes moyens, de dire des choses qui, éclairées quelque peu par les intuitions des artistes, rejoignent la terre et le ciel et sont au centre de moi-même.» Curieuse fraternité entre ces chercheurs d’étoiles, qu’ils aient évolué dans des équations intersidérales ou dans la constellation de l’art.
En quelque sorte, grâce à :
• son pouvoir d’imagination, l’homme féconde la démarche scientifique.
• Par sa capacité introspective, l’être se porte vers un absolu.
Se dépasser grâce à la transculturalité
Pour mieux comprendre le tiers, il faut donc non seulement analyser (couper en morceaux) la complexité mais il faut impérativement l’éclairer de différents phares, d’où l’urgence d’une transculturalité. Nous préférons d’ailleurs ce terme à interculturalité, ce dernier suggérant des échanges entre des entités hiératiques alors que le préfixe «trans» implique davantage de symbiose. Dans le domaine professionnel qui est le nôtre (l’enseignement de la neurologie à de futurs éducateurs spécialisés pour personnes handicapées), nous devons impérativement offrir une approche neuro-psychopédagogique, à savoir un triple diagnostic-action.8 Cette approche transdisciplinaire n’est pas à option, elle est indispensable. Ici et maintenant, une concertation, un langage commun, un dossier unique sous couvert de secret professionnel limité aux intervenants permettent de nous potentialiser les uns les autres.9
Tout particulièrement dans ces domaines de l’éducation et des soins, ne pas collaborer peut être considéré comme une forme de maltraitance.10 Ecoutons ce que nous dit le physicien et philosophe Bernard d’Espagnat :11 «Il serait nécessaire que les spécialistes en divers champs de pensées aient les uns avec les autres plus de communication que ce n’est actuellement le cas (…). Mais il est toujours très difficile de jeter des ponts entre les domaines différents de l’esprit (…). Tout bien considéré, ni l’esprit ni le monde ne sont, après tout, cloisonnés en compartiments. Les relations entre les différents domaines de la réflexion doivent par conséquent exister.»
Transculturalité est le mot que nous employons pour désigner les flux croisés, tant sur le plan des idées et des mentalités qu’au niveau des codes, entre les différents corps de métiers. Lesquels structurent souvent nos sociétés de manière trop monolithique. Davantage qu’un concept théorique, nous proposons une attitude pragmatique.
Flux sciences-poésie
Les faits sont connus : déjà Averroès était tout autant médecin que philosophe ; Léonard de Vinci montrait du génie tant en peinture, en ingénierie qu’en architecture ; l’honnête homme du XVIIe siècle était compétent en sciences et en humanités. L’explosion des connaissances aurait-elle stérilisé l’artiste ? Sans être omniscient, le poète doit-il rester dans sa tour d’ivoire en louant sa gente dame ou la magnificence des roses ? En réalité, il est en prise directe avec l’évolution sociale et une langue en perpétuelles mutations, lesquelles empruntent aux sciences des thèmes et des termes inédits. Si l’amour ou la beauté de la nature restent éternels, bien des préoccupations, des souffrances, des angoisses ont changé de visage. Par ailleurs, on ne s’exprime plus de la même manière qu’au Moyen Age ou qu’au XVIIIe siècle. A l’instar de l’art, la poésie ne doit pas être un refuge pour tricoteuses mélancoliques. On ne cessera d’affirmer qu’elle ne saurait se résumer à une versification, à des canons d’une autre époque ou même à un rythme particulier. Elle peut être prose, aphorisme, graffiti ou parole de rap, cette dernière s’inscrivant dans notre environnement urbain, par une tradition orale en plein retour. Nous allons même plus loin : il n’y a pas de littérature à proprement parler (dans le sens artistique du terme) sans une forme ou une autre de langage poétique.
Cela, bien entendu dans le cadre d’une lisibilité minimale. La poésie s’est parfois réfugiée dans l’impénétrable ou dans la facilité. Certains textes sont si abscons que seule une poignée d’initiés semblent pouvoir s’en gargariser. L’usage d’une cohérence interne, un soupçon d’autocritique et d’analyse de texte, démarches «scientifiques» pratiquées par des cohortes d’enseignants, pourraient faire parfois le plus grand bien à des poètes sortis de la cuisse de Jupiter. Malgré toutes les libertés et toute la folie créatrice qu’on est prêt à leur accorder, un peu de structure et un brin de grammaire donneraient ainsi à quelques productions molluscoïdes une ébauche de squelette.
Par ailleurs, bien que le poète soit viscéralement attaché à sa plume (lors de l’acte de création, on n’écrit, à notre sens, pas tout à fait la même chose avec de l’encre ou avec les touches d’un clavier), l’ordinateur et les moyens de transmission électronique sont devenus indispensables dans les rapports de l’écrivain avec les éditeurs et les revues, ne serait-ce que pour simplifier de fastidieux travaux de saisie, eux-mêmes sources d’erreurs. Bien que la présentation apparemment aboutie d’un texte sur écran puisse être parfois terreau de facilité et d’autosatisfaction précoce, la technologie donne au poète accès à la Toile (comme disent nos amis canadiens, à savoir internet) par des sites, blogs, forums de discussion, ce qui est un moyen supplémentaire de diffusion et de mise en réseau avec ses pairs.
Enfin, on ne saurait trop insister sur la possible et nécessaire collaboration de la poésie avec d’autres arts. Le temps de tristes recueils «tout gris» est à notre sens révolu.
L’interaction avec l’image et la musique, la production de CD ou de DVD avec la voix du poète ou les compétences d’un acteur rejoignent d’une certaine manière la symbiose avec d’autres moyens d’expression, comme c’était le cas dans le théâtre grec. Retour intéressant du destin ! Peut-être l’avenir de la poésie est-il ainsi dans la redécouverte d’une complémentarité aux formes plurielles : ne parle-t-on actuellement de multimédia ? Peut-être les techniques novatrices (télématique, digitalisation, laser, etc.) nous permettent-elles de réinventer cette transculturalité que l’on pratiquait spontanément il y a trois millénaires ?
Fécondation poésie-sciences
Mais que peut bien apporter cette démarche poétique, si humble et si intuitive, à l’orgueilleuse planète des sciences ?
Beaucoup ! Dans le sens d’une complémentarité entre l’inventivité et le champ des preuves expérimentales, (cf. l’imaginaire d’Einstein), dans le sens de l’introspection artistique ; mais aussi sur les chemins physiologiques de la créativité, sur des sentes humanistes et éthiques. Ecoutons Bachelard:12 «Le peintre, comme le poète, nous rendent à la grandeur des origines.» Phrase creuse, vide de sens ? Au contraire : reflet de ce supplément d’âme dont le besoin nous habite.
On sait que nombre de chercheurs ont en parallèle une activité artistique, en particulier musicale. Des psychologues américains ont récemment observé que les étudiants jouant d’un instrument réussissaient mieux leur parcours académique, en particulier dans le domaine scientifique. Comme si la créativité potentialisait la logique. Comme si le système limbique des émotions nourrissait les capacités cognitives. Protection mentale comme l’est, peut-être, la biochimie du rêve ? Equilibre physiologique entre l’intuitif et l’acquisition des connaissances ?
De leur côté, Rabelais, Tchekhov, Céline, Mondor, Duhamel, ou Jean Bernard et bien d’autres virent leur profession de médecin féconder leur plume. Est-ce là un hasard, une simple complémentarité du cerveau gauche (le cartésien) avec le cerveau droit (l’artistique) ? Diversité intellectuelle ou synergie ? Leurs rencontres des plus humbles d’entre nous, leur capacité d’observation et d’écoute ou le fait même de se situer à l’interface de disciplines apparemment si antinomiques ont-elles été le terreau de leur créativité ?
Le physicien et coïnventeur du CD, John-H. Reisner, grand connaisseur de Schopenhauer, en était intimement convaincu : la plupart des grandes découvertes (les micro-organismes par Pasteur, la pénicilline par Fleming, le rayonnement nucléaire par les Curie, etc.) ont été faites grâce à l’intuition, puis ont été développées et mises au point par le travail acharné d’équipes transdisciplinaires.
Plus près de nous, Olivier Jorand, professeur en sciences cognitives à l’Université de Lausanne et qui a consacré sa thèse d’habilitation aux réseaux de neurones, dit : «Jamais je ne serais devenu chercheur sans mon maître, le philosophe et humaniste Georges Savoy.»
On pensera également à l’urgence de réflexions éthiques : science sans conscience n’est que ruine de l’âme (Rabelais). Ou, comme l’écrit le médecin et théologien Thierry Collaud :13 «Nous vivons dans une culture où l’on a exagérément valorisé l’intervention technique. Nous avons cru mettre en elle tous nos espoirs et en sommes ressortis inévitablement déçus (…). Etre présent à autrui signifie croire en la possibilité qu’une relation s’établisse entre nous.» Sans développer ce thème qui nous est cher et qui sous-tend cet essai, il faut bien dire que l’éthique, par essence domaine interculturel où cohabitent philosophes, théologiens, psychologues, chercheurs etc., s’est affirmée comme une dimension essentielle des sciences et des techniques (Kutudjian, anc. directeur à l’UNESCO : in : Bioéthique… d’Azoux-Bacrie).14
Conclusion
Cette «valeur ajoutée» du 1 + 1 > 2, que nous avons évoquée en médecine, en psychologie, en philosophie, en art et en poésie, ce pouvoir de l’imaginaire et cette transculturalité sont effectivement des sésames pour tout scientifique, dans notre monde technologique qui effiloche son âme et se fragmente à outrance. Ce qui rejoint quelque part le on ne voit bien qu’avec le cœur : l’essentiel est invisible pour les yeux, de St-Exupéry.
Au même titre que l’écrivain et le médecin sont plus proches qu’on ne le croit (tous deux sont de grands observateurs de la «pâte humaine» et de la nature), poésie et science ne figurent pas aux antipodes l’une de l’autre. Nous nous référons ici à l’ouvrage de M. Couquiaud,6 L’horizon poétique de la connaissance, et au Manifeste de la transdisciplinarité du physicien B. Nicolescu,15 auteurs qui ont tout particulièrement approfondi les relations entre la physique et la poésie.
Ces itinéraires rejoignent le concept des humanités, à savoir l’acquisition d’un socle culturel commun donnant aux lycéens (entre autres !) les clés de connaissances générales avant celles d’outils pratiques à visée professionnelle. Que ce soit dans le monde universitaire, dans les hôpitaux ou dans les entreprises, il conviendrait non seulement d’accentuer les réflexions éthiques à propos des technologies en devenir, mais également d’associer plus systématiquement le monde des lettres, les historiens, les philosophes et les poètes aux sciences dites exactes. Sachant, bien entendu, que les uns et les autres ont leurs spécificités, leurs idiomes, leurs références, leurs équations. Néanmoins, quand on sait que la télématique est devenue, en quelques années, une manière d’espéranto universel, on se plaît à rêver d’un langage humaniste commun dans la tour de Babel de l’homo, dit sapiens.
Nous sommes dans un monde où le «marketing», la publicité, le «merchandising» accaparent les médias et captent la communication dans une optique marchande. Pour construire des ponts entre les champs de la pensée, le lève-toi et marche est la formation. Pourquoi ne pas envisager de créer une filière universitaire pour ceux qui deviendraient des passeurs interprofessionnels ? L’idée d’intellectuels se consacrant essentiellement à l’interactivité et à la didactique fait son chemin. Nouvelle gouvernance de l’esprit? Si cette proposition paradoxale de spécialiser quelques-uns d’entre nous en culture générale (à l’instar de disciples d’ Esculape spécialistes en médecine générale) peut paraître singulière, elle constitue, à notre sens, une piste ouverte vers l’avenir.
Car, en définitive, au travers d’une gémellité entre le scientifique et l’artiste, il ne s’agit pas d’accumuler des savoirs inessentiels mais de retenir de chaque discipline ce qui est utile à la vérité.16
Auteur :
Claude Luezior-Dessibourg
Ecrivain
Professeur de neurologie
Article entre médecine (Dessibourg) et création littéraire (Luezior), paru dans la Revue médicale suisse, 2009 et disponible sur le Net : revmed.ch/revuemedicale-suisse/2009 :
RÉFLEXION
Médecine, sciences humaines et art : approche transculturelle
Claude Luezior-Dessibourg
Depuis des temps immémoriaux, l’homme a eu besoin de maîtriser maints problèmes complexes que lui posait la nature. L’histoire des sciences, de Pythagore à de Broglie, en passant par Newton, Pasteur ou Curie, montre que le monde peut être analysé en nombre de lois, équations et formules pour essayer de comprendre.
Déjà ces grands savants, en sus de leur créativité, mais également de leur esprit de modestie eurent l’intuition que leurs découvertes n’étaient que le fragment d’une globalité qui les dépassait. Contrairement aux pures mathématiques, on s’est rendu compte, en particulier dans l’étude du vivant, que l’ensemble dépassait largement la somme des parties, en d’autres termes que 1 + 1 > 2.
Si le médecin a, de longue date, la conviction que l’homme est davantage que ses organes, le biologiste et le généticien modernes sont confrontés à une incroyable richesse dont l’analyse repousse sans cesse plus loin un principe de vie qui leur échappe…
Sur sa propre sente, le psychologue Jung, par l’étude des mythes, constate une manière de «valeur ajoutée» aux individus. Le philosophe et théologien Teilhard de Chardin,1 décrit un processus de complexification progressive de la matière, puis de l’homme et de la société vers Dieu, cheminement bien supérieur à un ensemble de mutations.
Il en est de même du phénomène artistique qui est précisément ce «plus» ajouté aux compétences académiques du peintre ou du musicien. La poésie, qu’elle soit scandée ou qu’elle se niche dans la prose, réside à la synapse des mots et va bien au-delà de la signification primaire de ceux-ci.
Chercheurs et créateurs n’ont pu faire l’économie d’un écartèlement de leurs acquis, d’une vision pluridimensionnelle afin d’aller au-delà de leur pré carré. Ainsi, un mathématicien comme Einstein ou un peintre mystique tel Niquille2 outils dépassé leurs domaines respectifs en inscrivant leur pensée, grâce à leur imaginaire et à leur «œil intérieur», dans une conception globale de l’univers. Devant la tendance à la surspécialisation de nos sociétés, nous constatons un besoin accru de porosité, de flux entre les sciences «dures» et les sciences humaines. Au-delà des fécondations culturelles entre les civilisations, c’est bien une interaction entre la «tribu» des scientifiques et celle des artistes qui est ici notre propos. Que dire en particulier des relations entre le monde scientifique et celui de la poésie ? Ces deux planètes, qui ont l’air de s’ignorer superbement et dont les modes de fonctionnement semblent singuliers, sont-elles en réalité si éloignées l’une de l’autre ?
Concrètement, à l’heure de nos cloisonnements mutuels, le maître mot de ces symbioses, serait-il la transculturalité ?
Les sciences peuvent-elles contribuer à structurer, nourrir l’imaginaire du poète, enrichir sa langue, lui offrir des outils novateurs, d’autres moyens d’expression, lui fournir une scène, voire des médias pour diffuser sa parole?
En retour, la poésie donnerait-elle à nos sociétés technologiques ce supplément d’âme dont elle a besoin, une appréhension plus globale de l’humain, l’occasion d’une réflexion cosmique et éthique, une approche intuitive indispensable à la création scientifique?
Analyser pour comprendre
On ne peut pas concevoir la physique sans particules élémentaires, la biologie sans cellules, l’électronique sans digitalisation. La science ne saurait exister sans l’analyse des phénomènes en processus fondamentaux. Approche brillante mais insuffisante. En effet, le chercheur est, malgré d’indéniables victoires, confronté à la nature qui est bien plus intelligente que nous, comme le dit dans un sourire Gianotti, physicienne au CERN, alors que matière et antimatière continuent à défier ses collègues…
La génétique, qui remplit des milliers d’ouvrages et des millions de pages internet, semble-t-elle résoudre une énigme ? En fait, elle entrouvre un labyrinthe. Le génome humain a-t-il été décrypté grâce à une foultitude d’ordinateurs ? Nous voilà devant une encyclopédie presque illisible, dont seules quelques clés sont à notre disposition. On est bien loin du rêve «un gène – une maladie», «un ciseau génétique – une guérison», la plupart des affections, notamment psychiques, étant polygéniques, à savoir dépendantes d’un ensemble de gènes interagissant les uns avec les autres. Voilà donc les espoirs de certains, pour ne pas dire l’arrogance d’autres, battus en brèche. La dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les psychoses, ne sont guère explicables par la régulation aberrante d’une partie précise du cerveau. La tendance actuelle est à les considérer comme des dysfonctions de réseaux neuronaux dans le cadre d’une nouvelle cartographie, plutôt dynamique qu’anatomique.
C’est ici qu’intervient le principe de modestie : le vrai scientifique n’est pas celui qui dit «je sais», mais celui qui dit «je ne sais pas», selon notre ancien professeur de chimie inorganique von Zelewsky. Phrase difficile à comprendre pour les doux carabins avides de connaissances que nous étions, au matin d’une leçon inaugurale. Et pourtant, la sentence n’a paradoxalement cessé de prendre de l’ampleur au fur et à mesure des décades, au cours desquelles un pauvre savoir s’est accumulé dans nos têtes. Un problème central en didactique est de définir les zones grises entre le je n’ai pas compris et le on ne comprend pas. Ce qui rend le cognitif nettement plus intelligible. Ce qui donne aussi aux sciences «dures» une tonalité de sciences «humaines». Le scientifique, c’est celui dont l’intelligence (de inter legere : choisir parmi) n’est pas arrêtée par ce qu’il sait, mais celui qui demeure dans l’ouvert de ce qu’il cherche.3
Etrange équation : 1+1> 2 : constellation biomédicale
Les mécanismes cellulaires intimes et des modes d’action pharmaceutiques restent donc largement méconnus. En dépit d’immenses recherches, la véritable cause de la sclérose en plaques, de l’Alzheimer ou de l’épilepsie, pour ne citer que ces affections, reste pour le moins mystérieuse. Malgré l’étude de l’être humain en organes, systèmes, entités génétiques et réseaux, malgré l’intégration de paramètres chimiques, pharmacologiques, biotechnologiques mais également psychologiques et sociologiques, on peut avoir l’impression, dans nos tentatives d’appréhension du vivant, de multiplier constamment les énigmes alors que l’hypothèse X vient d’être résolue.
Notre intention n’est pas d’entrer ici dans la dialectique «hasard et nécessité (Jacques Monod) face à la foi en un Dieu créateur de l’univers». Nous en sommes bien incapables : qui l’est réellement, d’ailleurs ? Notre position (assez fluide, il faut l’avouer, car nous sommes là dans des sables mouvants…) est un peu celle d’un panthéiste curieux et actif, celle d’un «simple», dans le sens philosophique du terme, d’un «ravi» face au jour qui se lève. Comme si la science, en l’occurrence la médecine (qui, en fait, trempe ses racines à la fois dans les sciences dures et les sciences humaines et qui les applique, tant que faire se peut, au patient – de patere, celui qui souffre –) ne cessait, en butte à l’insondable complexité, de se frotter à un principe tiers. Qu’on le nomme Dieu, Allah, la Nature ou le Hasard.
Doux amalgame entre la rigueur scientifique et une dimension philosophico-poétique ou nécessité vitale d’une pensée plus large pour supporter le quotidien en détresse ?
Psychologue et théologien
L’être humain est également histoire personnelle et expériences de vie, il s’inscrit dans la société et la société s’inscrit en lui. Les multiples interactions entre les individus les enrichissent, les construisent. Cette nécessité viscérale de relation à l’autre, qui rejoint le il n’y a de «je» que pour un «toi» et de «toi» que pour un «je» de Leloup4 est une constante chez l’homme. Il est évident que le corps social d’un milliard d’individus est supérieur à la somme de ses membres. Interviennent, parmi de nombreux facteurs, les tenants et aboutissants économiques, géographiques, historiques, culturels, mais également de grands mythes sur lesquels Jung a beaucoup insisté. Il en est de même des archétypes, images anciennes qui appartiennent au trésor commun de l’humanité. Ces représentations seraient indépendantes de toute acquisition personnelle et constituent l’inconscient collectif. Ce phénomène additionnel jouerait un rôle capital dans le comportement des masses mais également dans la construction intrapsychique des uns et des autres.
L’homme est, par ailleurs, projection de lui-même vers un plus haut qui le dépasse ; n’est-il ainsi, quelque part, également prière ? Aussi loin que l’anthropologie puisse aller, on a découvert dans les tombes les plus primitives des squelettes placés dans un certain ordre, des traces de peinture sacrée, des reliques et des amulettes, probables «traits d’union» avec une force supérieure. L’appétence pour une divinité a été décrite tant par des anthropologues, des psychologues, des sociologues, des historiens, que par des religieux de toutes obédiences. Druides, chamans, mages et prêtres (et pourquoi pas les poètes, dans le sens archaïque du terme, à savoir ceux qui «cherchent commerce avec l’infini», ceux qui «prient» pour une extension cosmique du quotidien) ont, à la fois par la lyre ou la croix, par la louange ou la quête d’un Graal, accompagnés vivants et morts au seuil de l’étrange barque les menant par delà le soleil.
Cette élévation de la matière vers l’homme, de l’homme vers un corps social qui lui-même monte vers le Corpus Christi est d’ailleurs l’axe de pensée d’un Teilhard de Chardin :1 «Vie et conscience ne sont plus des anomalies accidentelles de la nature ; mais dans la Biologie apparaît soudain une face complémentaire de la Physique et de la Matière. Ici, je le répète, l’Etoffe du Monde qui se désagrège en rayonnant son énergie complémentaire, et là, cette même étoffe qui se rassemble en rayonnement de la Pensée. Du fantastique aux deux extrémités. Mais l’un n’est-il pas nécessaire pour équilibrer l’autre ?» Si tous n’adhèrent pas à la vision globale, pour ne pas dire poétique, de Teilhard, force est de constater, même dans une société laïcisée comme la nôtre, le besoin incoercible, dans toute l’histoire de l’humanité, d’un «plus», d’une force centrifuge vers un au-delà.
Peintre et poète
En sus des sentiers biomédical, psychologique et philosophique brièvement évoqués plus haut, un modèle illustrant le singulier axiome 1 + 1 > 2 est le domaine artistique, en particulier la poésie. Comme si cette discipline devenue marginale pour la plupart de nos contemporains recelait en elle un mode de fonctionnement exemplaire à partir du langage dit «véhiculaire» (qui porte le sens usuel des mots).
Dire que la peinture va au-delà du trait représentant l’objet figuré et bien au-delà du support employé ou de la couleur est un truisme. Elle est avant tout une vision déformée, amalgamée, reconstruite dans le cortex du peintre. Certains tableaux peuvent devenir buissons ardents qui, sous la qualité d’un vrai regard, s’enflamment.5 Il en est de même en poésie : émotion secrétée à la synapse du verbe, elle n’est plus langue ordinaire mais devient authentique création. Elle est par essence l’étincelle à la faille de plaques tectoniques, la plus-value du 1 + 1 qui est bien davantage que 2. Ce, contrairement aux personnes qui réduisent la poésie à une formule littéraire verticale et rimée. Sang de l’écriture, elle lui propose son style. Elle est, pour citer Couquiaud,6 ce «Tiers exclu» qui naît lors d’un changement de niveau au sein de la sensibilité et du rapport entre les mots. Ce phénomène est généré dans une parentalité auteur-lecteur. Ce dernier participe avec son propre vécu, son propre psychisme. D’où vibration, communion avec le poète : «j’aurais voulu dire cela». D’où stade ultime d’adéquation avec le cosmos, de plénitude, de prière. Selon l’expression de Berenson :7 Le moment esthétique devient un moment de vision mystique.
En résumé, si la démarche analytique est grande pourvoyeuse de connaissances, il paraît évident qu’une approche plus large est pour le moins indispensable afin d’appréhender la cosmographie humaine. Contrairement aux pures équations mathématiques.
Ainsi :
• l’être est supérieur à l’ensemble de ses organes (y compris son cerveau).
• L’humanité est davantage que la somme de milliards d’individus.
• L’évolution est plus que l’addition de mutations désordonnées.
• La peinture dépasse la reproduction d’une réalité et la poésie est magie secrétée à l’interface des mots.
Se dépasser grâce à l’imaginaire et à l’introspection
Pour cette alchimie «supramathématique», comment l’homme parvient-il à se dépasser ? Einstein a proposé cette phrase assez surprenante : «L’imaginaire est plus important que la connaissance.» Son propos étant qu’il fallait parfois, d’abord, un rêve, un concept, une vision, avant que les équations et les expérimentations puissent les prouver. Citons ici également le peintre mystique Niquille :5 «Toujours plus loin dans une sorte de théologie de l’œil. Où l’œil intérieur s’allie au regard extérieur pour atteindre l’intelligence de l’âme.» Lui qui disait : «Je ne suis qu’un artisan au pied de la croix.» ou encore : «Si je prends la plume, c’est avec la volonté presque désespérée, au-dessus de mes forces et de mes moyens, de dire des choses qui, éclairées quelque peu par les intuitions des artistes, rejoignent la terre et le ciel et sont au centre de moi-même.» Curieuse fraternité entre ces chercheurs d’étoiles, qu’ils aient évolué dans des équations intersidérales ou dans la constellation de l’art.
En quelque sorte, grâce à :
• son pouvoir d’imagination, l’homme féconde la démarche scientifique.
• Par sa capacité introspective, l’être se porte vers un absolu.
Se dépasser grâce à la transculturalité
Pour mieux comprendre le tiers, il faut donc non seulement analyser (couper en morceaux) la complexité mais il faut impérativement l’éclairer de différents phares, d’où l’urgence d’une transculturalité. Nous préférons d’ailleurs ce terme à interculturalité, ce dernier suggérant des échanges entre des entités hiératiques alors que le préfixe «trans» implique davantage de symbiose. Dans le domaine professionnel qui est le nôtre (l’enseignement de la neurologie à de futurs éducateurs spécialisés pour personnes handicapées), nous devons impérativement offrir une approche neuro-psychopédagogique, à savoir un triple diagnostic-action.8 Cette approche transdisciplinaire n’est pas à option, elle est indispensable. Ici et maintenant, une concertation, un langage commun, un dossier unique sous couvert de secret professionnel limité aux intervenants permettent de nous potentialiser les uns les autres.9
Tout particulièrement dans ces domaines de l’éducation et des soins, ne pas collaborer peut être considéré comme une forme de maltraitance.10 Ecoutons ce que nous dit le physicien et philosophe Bernard d’Espagnat :11 «Il serait nécessaire que les spécialistes en divers champs de pensées aient les uns avec les autres plus de communication que ce n’est actuellement le cas (…). Mais il est toujours très difficile de jeter des ponts entre les domaines différents de l’esprit (…). Tout bien considéré, ni l’esprit ni le monde ne sont, après tout, cloisonnés en compartiments. Les relations entre les différents domaines de la réflexion doivent par conséquent exister.»
Transculturalité est le mot que nous employons pour désigner les flux croisés, tant sur le plan des idées et des mentalités qu’au niveau des codes, entre les différents corps de métiers. Lesquels structurent souvent nos sociétés de manière trop monolithique. Davantage qu’un concept théorique, nous proposons une attitude pragmatique.
Flux sciences-poésie
Les faits sont connus : déjà Averroès était tout autant médecin que philosophe ; Léonard de Vinci montrait du génie tant en peinture, en ingénierie qu’en architecture ; l’honnête homme du XVIIe siècle était compétent en sciences et en humanités. L’explosion des connaissances aurait-elle stérilisé l’artiste ? Sans être omniscient, le poète doit-il rester dans sa tour d’ivoire en louant sa gente dame ou la magnificence des roses ? En réalité, il est en prise directe avec l’évolution sociale et une langue en perpétuelles mutations, lesquelles empruntent aux sciences des thèmes et des termes inédits. Si l’amour ou la beauté de la nature restent éternels, bien des préoccupations, des souffrances, des angoisses ont changé de visage. Par ailleurs, on ne s’exprime plus de la même manière qu’au Moyen Age ou qu’au XVIIIe siècle. A l’instar de l’art, la poésie ne doit pas être un refuge pour tricoteuses mélancoliques. On ne cessera d’affirmer qu’elle ne saurait se résumer à une versification, à des canons d’une autre époque ou même à un rythme particulier. Elle peut être prose, aphorisme, graffiti ou parole de rap, cette dernière s’inscrivant dans notre environnement urbain, par une tradition orale en plein retour. Nous allons même plus loin : il n’y a pas de littérature à proprement parler (dans le sens artistique du terme) sans une forme ou une autre de langage poétique.
Cela, bien entendu dans le cadre d’une lisibilité minimale. La poésie s’est parfois réfugiée dans l’impénétrable ou dans la facilité. Certains textes sont si abscons que seule une poignée d’initiés semblent pouvoir s’en gargariser. L’usage d’une cohérence interne, un soupçon d’autocritique et d’analyse de texte, démarches «scientifiques» pratiquées par des cohortes d’enseignants, pourraient faire parfois le plus grand bien à des poètes sortis de la cuisse de Jupiter. Malgré toutes les libertés et toute la folie créatrice qu’on est prêt à leur accorder, un peu de structure et un brin de grammaire donneraient ainsi à quelques productions molluscoïdes une ébauche de squelette.
Par ailleurs, bien que le poète soit viscéralement attaché à sa plume (lors de l’acte de création, on n’écrit, à notre sens, pas tout à fait la même chose avec de l’encre ou avec les touches d’un clavier), l’ordinateur et les moyens de transmission électronique sont devenus indispensables dans les rapports de l’écrivain avec les éditeurs et les revues, ne serait-ce que pour simplifier de fastidieux travaux de saisie, eux-mêmes sources d’erreurs. Bien que la présentation apparemment aboutie d’un texte sur écran puisse être parfois terreau de facilité et d’autosatisfaction précoce, la technologie donne au poète accès à la Toile (comme disent nos amis canadiens, à savoir internet) par des sites, blogs, forums de discussion, ce qui est un moyen supplémentaire de diffusion et de mise en réseau avec ses pairs.
Enfin, on ne saurait trop insister sur la possible et nécessaire collaboration de la poésie avec d’autres arts. Le temps de tristes recueils «tout gris» est à notre sens révolu.
L’interaction avec l’image et la musique, la production de CD ou de DVD avec la voix du poète ou les compétences d’un acteur rejoignent d’une certaine manière la symbiose avec d’autres moyens d’expression, comme c’était le cas dans le théâtre grec. Retour intéressant du destin ! Peut-être l’avenir de la poésie est-il ainsi dans la redécouverte d’une complémentarité aux formes plurielles : ne parle-t-on actuellement de multimédia ? Peut-être les techniques novatrices (télématique, digitalisation, laser, etc.) nous permettent-elles de réinventer cette transculturalité que l’on pratiquait spontanément il y a trois millénaires ?
Fécondation poésie-sciences
Mais que peut bien apporter cette démarche poétique, si humble et si intuitive, à l’orgueilleuse planète des sciences ?
Beaucoup ! Dans le sens d’une complémentarité entre l’inventivité et le champ des preuves expérimentales, (cf. l’imaginaire d’Einstein), dans le sens de l’introspection artistique ; mais aussi sur les chemins physiologiques de la créativité, sur des sentes humanistes et éthiques. Ecoutons Bachelard:12 «Le peintre, comme le poète, nous rendent à la grandeur des origines.» Phrase creuse, vide de sens ? Au contraire : reflet de ce supplément d’âme dont le besoin nous habite.
On sait que nombre de chercheurs ont en parallèle une activité artistique, en particulier musicale. Des psychologues américains ont récemment observé que les étudiants jouant d’un instrument réussissaient mieux leur parcours académique, en particulier dans le domaine scientifique. Comme si la créativité potentialisait la logique. Comme si le système limbique des émotions nourrissait les capacités cognitives. Protection mentale comme l’est, peut-être, la biochimie du rêve ? Equilibre physiologique entre l’intuitif et l’acquisition des connaissances ?
De leur côté, Rabelais, Tchekhov, Céline, Mondor, Duhamel, ou Jean Bernard et bien d’autres virent leur profession de médecin féconder leur plume. Est-ce là un hasard, une simple complémentarité du cerveau gauche (le cartésien) avec le cerveau droit (l’artistique) ? Diversité intellectuelle ou synergie ? Leurs rencontres des plus humbles d’entre nous, leur capacité d’observation et d’écoute ou le fait même de se situer à l’interface de disciplines apparemment si antinomiques ont-elles été le terreau de leur créativité ?
Le physicien et coïnventeur du CD, John-H. Reisner, grand connaisseur de Schopenhauer, en était intimement convaincu : la plupart des grandes découvertes (les micro-organismes par Pasteur, la pénicilline par Fleming, le rayonnement nucléaire par les Curie, etc.) ont été faites grâce à l’intuition, puis ont été développées et mises au point par le travail acharné d’équipes transdisciplinaires.
Plus près de nous, Olivier Jorand, professeur en sciences cognitives à l’Université de Lausanne et qui a consacré sa thèse d’habilitation aux réseaux de neurones, dit : «Jamais je ne serais devenu chercheur sans mon maître, le philosophe et humaniste Georges Savoy.»
On pensera également à l’urgence de réflexions éthiques : science sans conscience n’est que ruine de l’âme (Rabelais). Ou, comme l’écrit le médecin et théologien Thierry Collaud :13 «Nous vivons dans une culture où l’on a exagérément valorisé l’intervention technique. Nous avons cru mettre en elle tous nos espoirs et en sommes ressortis inévitablement déçus (…). Etre présent à autrui signifie croire en la possibilité qu’une relation s’établisse entre nous.» Sans développer ce thème qui nous est cher et qui sous-tend cet essai, il faut bien dire que l’éthique, par essence domaine interculturel où cohabitent philosophes, théologiens, psychologues, chercheurs etc., s’est affirmée comme une dimension essentielle des sciences et des techniques (Kutudjian, anc. directeur à l’UNESCO : in : Bioéthique… d’Azoux-Bacrie).14
Conclusion
Cette «valeur ajoutée» du 1 + 1 > 2, que nous avons évoquée en médecine, en psychologie, en philosophie, en art et en poésie, ce pouvoir de l’imaginaire et cette transculturalité sont effectivement des sésames pour tout scientifique, dans notre monde technologique qui effiloche son âme et se fragmente à outrance. Ce qui rejoint quelque part le on ne voit bien qu’avec le cœur : l’essentiel est invisible pour les yeux, de St-Exupéry.
Au même titre que l’écrivain et le médecin sont plus proches qu’on ne le croit (tous deux sont de grands observateurs de la «pâte humaine» et de la nature), poésie et science ne figurent pas aux antipodes l’une de l’autre. Nous nous référons ici à l’ouvrage de M. Couquiaud,6 L’horizon poétique de la connaissance, et au Manifeste de la transdisciplinarité du physicien B. Nicolescu,15 auteurs qui ont tout particulièrement approfondi les relations entre la physique et la poésie.
Ces itinéraires rejoignent le concept des humanités, à savoir l’acquisition d’un socle culturel commun donnant aux lycéens (entre autres !) les clés de connaissances générales avant celles d’outils pratiques à visée professionnelle. Que ce soit dans le monde universitaire, dans les hôpitaux ou dans les entreprises, il conviendrait non seulement d’accentuer les réflexions éthiques à propos des technologies en devenir, mais également d’associer plus systématiquement le monde des lettres, les historiens, les philosophes et les poètes aux sciences dites exactes. Sachant, bien entendu, que les uns et les autres ont leurs spécificités, leurs idiomes, leurs références, leurs équations. Néanmoins, quand on sait que la télématique est devenue, en quelques années, une manière d’espéranto universel, on se plaît à rêver d’un langage humaniste commun dans la tour de Babel de l’homo, dit sapiens.
Nous sommes dans un monde où le «marketing», la publicité, le «merchandising» accaparent les médias et captent la communication dans une optique marchande. Pour construire des ponts entre les champs de la pensée, le lève-toi et marche est la formation. Pourquoi ne pas envisager de créer une filière universitaire pour ceux qui deviendraient des passeurs interprofessionnels ? L’idée d’intellectuels se consacrant essentiellement à l’interactivité et à la didactique fait son chemin. Nouvelle gouvernance de l’esprit? Si cette proposition paradoxale de spécialiser quelques-uns d’entre nous en culture générale (à l’instar de disciples d’ Esculape spécialistes en médecine générale) peut paraître singulière, elle constitue, à notre sens, une piste ouverte vers l’avenir.
Car, en définitive, au travers d’une gémellité entre le scientifique et l’artiste, il ne s’agit pas d’accumuler des savoirs inessentiels mais de retenir de chaque discipline ce qui est utile à la vérité.16
- 1 ** De Chardin T. L’Avenir de l’homme. Paris : Le Seuil, 1962.
- 2 Luezior C, Biolley J. Niquille, maître de lumière. Fribourg : La Sarine, 1996.
- 3 Leloup JY. Désert, déserts. Paris : Albin Michel, 1996.
- 4 Leloup JY. Manque et plénitude. Paris : Albin Michel, 2001.
- 5 Niquille A. Le veilleur de solitude. Fribourg : La Sarine, 1992.
- 6 Couquiaud M. L’horizon poétique de la connaissance. Paris : L’Harmattan, 2003.
- 7 Berenson B. Esthétique et histoire des arts visuels. Paris : Albin Michel, 1953.
- 8 Dessibourg CA. Le triple diagnostic chez l’enfant et l’adulte handicapés : une approche clinique. Paris : Revue Handicap, 2005;107-8.
- 9 * Dessibourg CA. Approche transdisciplinaire de la déficience mentale. Paris : Masson-Elsevier, 2009, in print.
- 10 * Dessibourg CA, Lambert JL. Traitements médicaux et personnes déficientes intellectuelles. Genève : Médecine et Hygiène, 2007.
- 11 D’Espagnat B. A la recherche du réel. Paris : Agora,1991.
- 12 Bachelard G. Le droit de rêver. Paris : PUF, 2002.
- 13 Collaud T. Réflexion théologique sur l’éthique de la santé. Fribourg : Universitas, 2006.
- 14 Azoux-Bacrie L. Bioéthique, bioéthiques. Bruxelles : Bruylan, 2003.
- 15 Nicolescu B. La Transdisciplinarité (manifeste). Monaco : Le Rocher, (égal. recension par Couquiaud M, in Phréatiques n° 77, Paris), 1996.
- 16 Leloup JY. L’Absurde et la grâce. Paris : Albin Michel, 1997.
Auteur :
Claude Luezior-Dessibourg
Ecrivain
Professeur de neurologie